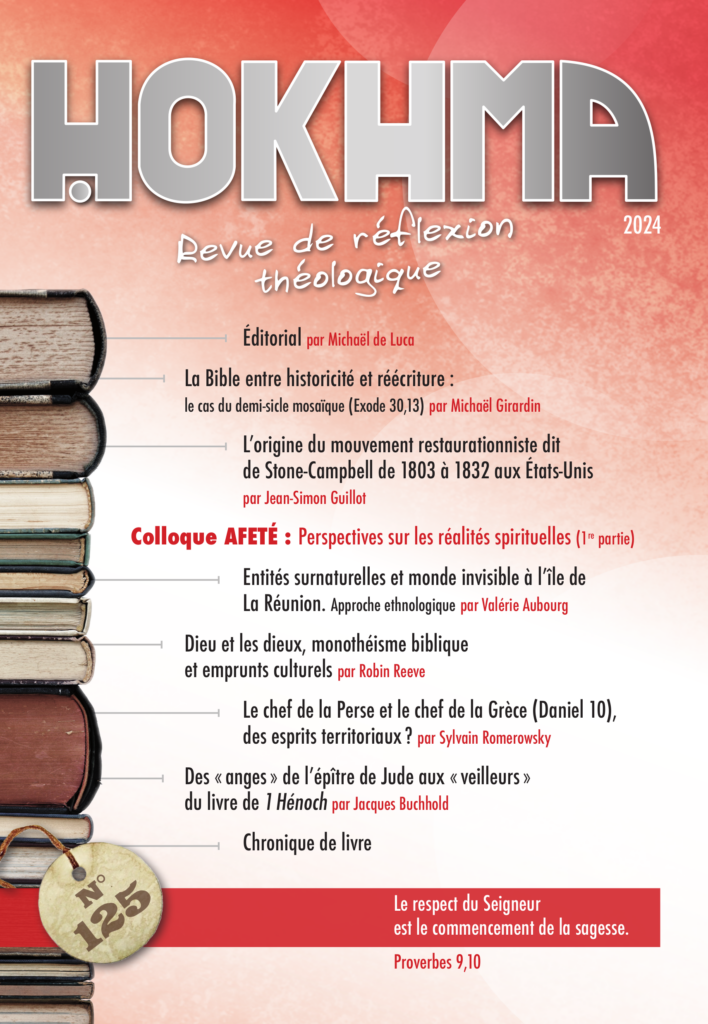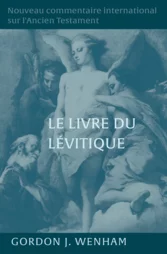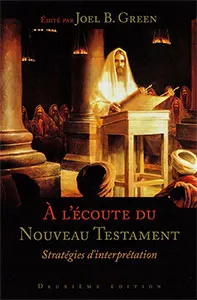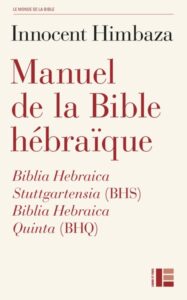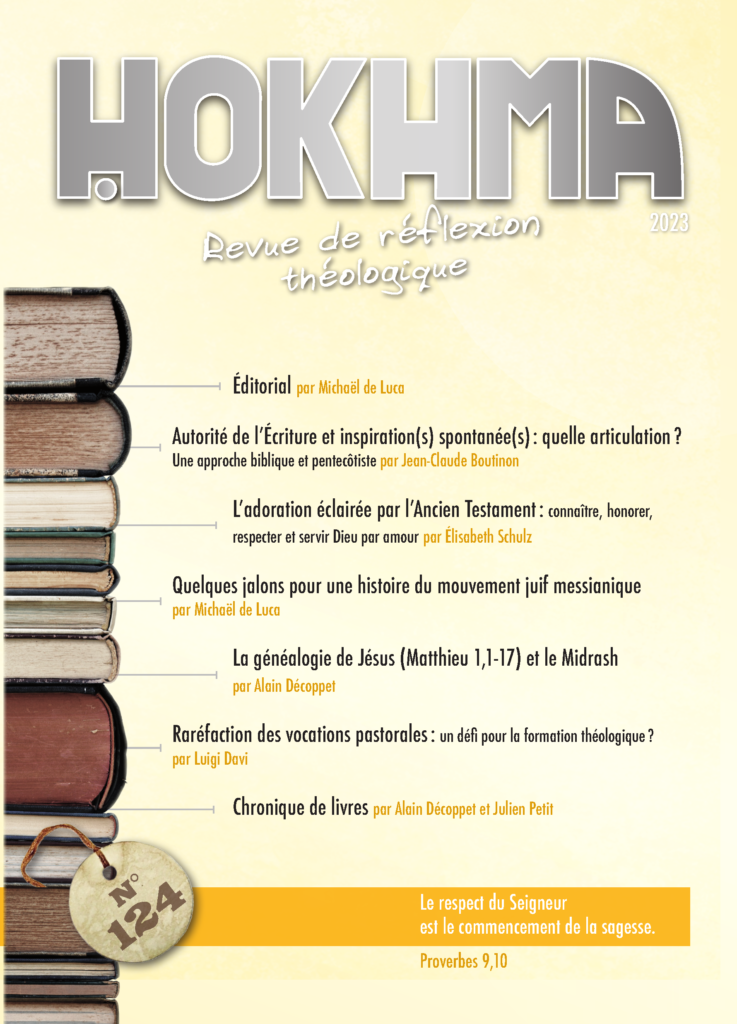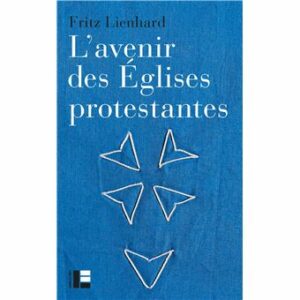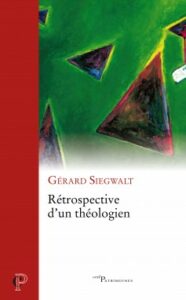par Jean BRUN,
professeur de philosophie à Dijon
I Le Dieu de Hegel
La philosophie de Hegel possède une importance exceptionnelle dans la mesure où elle constitue la plaque tournante des synthèses entre la théologie, la philosophie, l’histoire, la sociologie et la politique. Dans sa jeunesse, Hegel avait fait des études de théologie en pensant devenir ensuite pasteur; s’il s’orienta vers la philosophie et prétendit rester profondément luthérien, il n’en reste pas moins que sa pensée est à l’origine de nombreux courants contemporains, aussi bien dans le domaine de la théologie que dans celui de la politique. Certains ont vu en lui le théoricien de l’Etat prussien (hégélianisme de droite), d’autres l’ancêtre de Feuerbach, Marx et Lénine (hégélianisme de gauche). Quoi qu’il en soit, avec Hegel le christianisme s’est trouvé infléchi vers une sécularisation très nette. Hegel se pose essentiellement des problèmes de réconciliation d’opposés ou de contradictoires. Il veut faire la synthèse de la Grèce et du Christianisme, du Temps et de l’Eternité, de l’Etre et du Devenir, de l’Individu et de la Totalité, du Citoyen et de l’Etat, de Dieu et de l’Homme, du Cœur et de l’Esprit, du Romantisme et du Rationalisme, de la Moralitat et de la Sittlichkeit, et surtout la synthèse du Fini et de l’Infini. Toutes ces réconciliations s’insèrent dans une philosophie qui se présente comme la synthèse d’une théologie du Dieu Vivant et d’une philosophie de l’histoire. Pour ce faire, Hegel désubstantialise la notion de Dieu pour mettre l’accent sur la notion du Verbe. Le thème chrétien: «Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » se trouvera ainsi transposé en une perspective dialectico-historique dans laquelle l’Histoire sera le Chemin et la Vie de Dieu se déifiant dans et par le temps à travers une Eternité en marche. Dire avec Hegel que «l’Absolu est résultat», c’est dire, mais d’une façon nouvelle, qu’il est l’Alpha et l’Oméga.
Kénose et aliénation divine
On lit dans Philippiens 2. 7 que Jésus «s’est dépouillé (ékénôsen) lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes » ; ce dépouillement, cette « kénose », par lequel Dieu s’est «vidé» pour ainsi dire de lui-même pour devenir homme, est ainsi donné pour une espèce d’aliénation de Dieu (qui devient autre que lui-même) et en même temps pour la preuve du plus grand amour. Une telle idée se retrouve chez Hegel, mais dynamisée et dialectisée par le « travail du négatif » : « La vie de Dieu et la connaissance divine peuvent donc bien, si l’on veut, être exprimées comme un jeu de l’amour avec soi-même ; mais cette idée s’abaisse jusqu’à l’édification et même jusqu’à la fadeur quand y manquent le sérieux, la douleur, la patience et le travail du négatif » (Phénoménologie de r esprit, trad. t. 1 p. 18) (sur la kénose cf. Hegel Philosophie de la religion, trad. t. V p. 32 ; sur la mort de Dieu cf. op. cit. p. 156 et Phénoménologie t. II p. 262 et 287). Il faut donc que Dieu « se nie », meure, afin de pouvoir continuer d’être, sans cesse, et toujours différemment, lui-même ; c’est cette Vie, ce travail du négatif et cette aliénation incessante qui font de l’Absolu, de l’Esprit, une palpitation sans fin.
Incarnation, Parousie et Histoire
L’aliénation historico-dialectique de Dieu n’est autre que la Révélation de Dieu dans l’Histoire tenue pour le « calvaire de l’Esprit Absolu » au cours duquel le sacrifice du Fils est sans cesse recommencé. La mort de Dieu n’est donc plus un événement localisé et daté, n’ayant eu lieu qu’une fois dans le temps des hommes, elle devient le moteur dialectique qui réconcilie l’Etre et le Devenir ; en effet, chaque civilisation constitue, aux yeux de Hegel, une Incarnation de l’Absolu dans le temps et dans l’espace, une sécularisation de Dieu. La mort d’une civilisation répète celle du Christ, l’avènement d’une nouvelle civilisation qui surgit des cendres de la précédente n’est autre que la répétition dans l’histoire de la remontée à la droite du Père. L’histoire devient ainsi la dimension ontologique par excellence dans la mesure où elle est la Manifestation de l’Absolu qui vit, meurt et renaît telle Phénix. D’où l’idée typiquement hégélienne que « Geist ist Zeit » (L’Esprit est Temps) et que «le Vrai est le devenir de soi-même» (Phénoménologie t. 1 , p. 18). Nous retrouvons donc là, mais dynamisée par l’histoire, une idée de Me Eckhart selon laquelle sans le monde Dieu ne serait pas Dieu ; cette philosophie hégélienne de l’histoire reprend également une vieille idée gnostique selon laquelle la théogonie et la cosmogonie ne font qu’un (cf. plus tard la même idée chez Teilhard de Chardin ; toutefois, chez lui le temps ne sera plus celui de l’histoire, mais celui de l’Evolution biologique tenue pour la Parousie du Verbe). Quant au Grand Homme, sur qui opère la « ruse de la Raison » absolue qui lui laisse croire qu’il agit de son plein gré alors qu’elle se sert de lui pour assurer la marche en avant de l’histoire, il est, à la manière du prophète, un instrument entre les mains du Dieu vivant dans l’histoire et les événements (d’où les appellations inconsciemment hégéliennes qu’utilisent ceux qui glorifient, selon leur terminologie, l’Homme Providentiel, le Guide ou le Petit Père des Peuples, voire le Grand Timonier).
La Mort
On lit dans Jean 12. 24 : «Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits». Cette idée se retrouve chez Hegel pour qui, tout comme la mort provient de la vie, de même la vie renaît de la mort. Autrement dit : pour qu’une civilisation nouvelle naisse, il est nécessaire que meure celle qu’elle remplace. Nous nous trouvons donc en présence d’un dépassement dialectique dans et par lequel toute négation se trouve niée à son tour. La fleur nie le bouton et naît de la mort de celui-ci, tout comme le fruit naîtra de la mort de la fleur qu’il niera en la dépassant (Aufhebung). Ainsi, en tant que négation de la négation, le dépassement dialectique assure la mort de la mort (cf. Philo de la Relig. t. IV, p. 160). Le « 0 Mort où est ta victoire ? » est donc proféré par le dialecticien de l’histoire qui nous montre que toute mort est moteur d’une naissance. Y comprise la mort de Dieu. Nous pouvons donc dire que cette suite ininterrompue de naissances, de vies et de morts du Christ dans le devenir de l’histoire, qui est en même temps celui de Dieu, fait du Verbe Incarné non seulement le Médiateur, mais la médiation qui opère la synthèse du fini et de l’infini.
Rédemption, rémission et réconciliation
La Vie de l’Esprit absolu dans l’histoire possède en fin de compte la mission traditionnellement attribuée au Jugement dernier ; mais ici c’est demain qui nous délivrera d’aujourd’hui, tout comme aujourd’hui nous a délivrés d’hier. Tout ce qui (dans le christianisme, relevait de l’eschatologie va désormais relever de l’Histoire. Le grand et seul Tribunal est donc, en définitive, celui de l’Histoire, Vie de Dieu dans et par le Temps. Un tel point de vue a finalement pour conséquence que le sens et la valeur d’un acte sont toujours en sursis ; pour pouvoir se prononcer sur la valeur d’un acte, il faut savoir ce qu’il en résultera. C’est ainsi que Kojève, un interprète marxisto-heideggerien de Hegel, nous dit que si un homme tue un roi, il faut attendre de voir ce qui résultera de ce geste pour pouvoir le juger. Si le peuple pleure son roi et maudit celui qui le lui a ravi, alors il faut dire que ce dernier est un assassin ; mais si une révolution populaire suit la disparition du roi, alors celui qui l’a tué ne doit pas être considéré comme un assassin mais bien comme un héros, comme un modèle de vertu et de civisme (cf. A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, Paris 1947, p. 463 ; cet ouvrage, plus que discutable mais assez original, a été pillé par beaucoup de philosophes français qui se gardent bien de le citer). Il n’y a donc pas, à proprement parler, de mal radical, puisque toute faute est, en définitive, une felix culpa dans la mesure où elle a pu donner naissance à ce qui la rectifia en la dépassant. C’est pourquoi la vertu eschatologicodialectique de l’histoire, telle que Hegel la conçoit, l’amène à dire : « Les blessures de l’Esprit se guérissent sans laisser de cicatrices » (Phénoménologie, t. II, p. 197). Le futur est ainsi investi d’assurer le dépassement de la mort: « L’Esprit peut faire que ce qui a été fait ne le soit pas ; l’action demeure bien dans le souvenir, mais l’Esprit l’efface » (Philo. de la Relig. t. IV, p. 165). C’est donc l’Histoire qui assure le pardon et le rachat des péchés dans la mesure où ils ont pu donner naissance à un futur qui les a dépassés.
L’Eglise et l’Etat
On trouve de nombreux textes dans les Ecritures qui précisent que l’Eglise est le corps du Christ dont nous sommes les membres. Une telle idée va se retrouver chez Hegel, mais laïcisée et sécularisée puisque, finalement, l’Etat prendra la place de l’Eglise et cherchera à jouer le rôle que celle-ci assumait jusqu’alors. L’Etat va être chargé d’assurer la synthèse de l’individu fini et de l’Infini, et cela pas seulement sociologiquement, mais ontologiquement.
La démarche hégélienne revient à dire que le Geist qui devient Weltgeist et se découvre Volksgeist, trouve finalement dans l’Etat l’Incarnation de l’Idée : « L’Universel qui s’affirme et se connaît dans l’Etat, la forme sous laquelle tout est produit, est ce qui constitue en général la culture d’une nation. Mais le contenu déterminé qui reçoit cette forme de l’universalité et se trouve contenu dans la réalité concrète créée par l’Etat, est l’Esprit même du Peuple» (La Raison dans l’Histoire, trad. Kostas Papaioannou, Paris 1965, p. 139). Donc « l’idée universelle se manifeste dans l’Etat… La Manifestation de l’Esprit est sa propre auto-détermination et les Etats et les individus nous offrent les figures dans lesquelles nous devons étudier la manifestation de l’Esprit» (op. cit., p. 138-139). L’Etat est donc l’organisme dont les citoyens sont membres, organisme qui est une incarnation de l’Esprit absolu : « L’Etat est vraiment issu de la religion» (op. cit., p. 155). Cette théorie organique de l’Etat permet à Hegel de dire clairement: «L’Etat n’existe pas pour le citoyen. On pourrait dire que l’Etat est la fin et les citoyens les moyens. Mais le rapport fin-moyens n’a pas de validité ici, car l’Etat n’est pas une abstraction qui se dresse face aux citoyens, mais ceux-ci sont ses moments, comme dans la vie organique où aucun membre n’est la fin ou le moyen d’un autre. Ce qu’il y a de divin dans l’Etat, c’est l’Idée telle qu’elle existe sur terre » (op. cit., p. 137). Ainsi peuvent être « divinisées » deux théories dont nous voyons de nombreux exemples autour de nous, théories auxquelles de nombreux chrétiens donnent leur adhésion : 1o La théorie totalitaire pour laquelle l’individu est un simple atome sans signification et qui doit donc vivre par et pour l’Etat (d’où les dénonciations de l’individualisme). Théorie que l’on retrouverait aussi bien dans les théories nazies que dans les théories communistes de l’Etat. 2o La théorie selon laquelle il existe un Etat qui est le pilote de l’histoire et en face duquel les autres Etats sont sans droit ; Hegel précise en effet que le peuple en qui l’Esprit absolu vient momentanément s’incarner « est le peuple dominant dans l’histoire universelle pour l’époque correspondante. Il ne peut faire époque qu’une seule fois dans l’histoire et contre ce droit absolu qu’il a parce qu’il est le représentant du degré actuel de développement de l’Esprit du Monde, les autres peuples sont sans droits, et ceux-ci aussi bien que ceux dont l’époque est passée, ne comptent plus dans l’histoire universelle » (Principes de la philo du droit, § 347). C’est ainsi que, aujourd’hui, de nombreux théologiens se mettent au service de partis politiques qui prétendent posséder la science du «Sens de l’Histoire». Ce faisant, ils s’imaginent se mettre au service de Dieu, d’un Dieu qui se fait dans l’histoire et qui se confond finalement avec l’Humanité. Une fois de plus, on confond Dieu et César. On pense que les œuvres remplacent la Grâce et l’on sombre dans tous les hystérismes, dans toutes les théologies de la « bonne » violence, de la révolution, de « l’insurrection chrétienne» (R. P. Cardonnel) sous le prétexte que le Christ est venu apporter le glaive et non la paix. Les politiciens utilisent alors les théologiens exactement comme les rois avaient utilisé les Aufklarer français défenseurs du « despotisme éclairé» », au XVIIIe siècle: ils les chargent d’angéliser leurs actes et leurs paroles. Finalement, on retombe ainsi dans une position extrêmement réactionnaire : jadis on bénissait les canons, aujourd’hui on bénit les cocktails Molotov, naguère on dénonçait le mariage du « sabre et du goupillon », aujourd’hui on célèbre les noces de la « mitraillette et du goupillon». Nous sommes revenus au pire des paganismes : celui qui se sert de Dieu en prétendant le servir.
II. La notion hégélienne de réconciliation
Le temps
La notion de réconciliation (Versohnung) est une des notions-clefs du hégélianisme. Hegel veut parvenir à l’accord du discordant, à la transformation du malheur en bonheur. Pour cela, il va chercher à placer le non dans le oui, à faire voir le multiple dans l’un, le fini dans l’infini, le temps, le mouvement et l’inquiétude dans l’éternel. Dans cette opération, le temps joue un rôle essentiel, il ne s’agira pas de trouver l’éternité dans le temps (Spinoza, Schleiermacher) mais de trouver le temps dans l’éternité. Le temps possédera ainsi un double caractère : il sera à la fois destructeur et créateur. D’où ce passage essentiel de l’Encyclopédie : « Le temps comme unité négative de l’être hors de soi est aussi un abstrait, un idéal. C’est l’être qui, en étant, n’est pas et n’étant pas, est; c’est le devenir appréhendé par l’intuition, i. e. que les différences purement momentanées, c’est-à-dire se mettant à l’écart immédiatement, sont déterminées comme extérieures, c’est-à-dire toutefois, extérieures à elles-mêmes … Ce n’est pas dans le temps que tout se produit et passe, mais le temps même est ce devenir, cette production et cet anéantissement, l’abstraction existante. Kronos qui engendre tout et détruit tout ce qu’il produit (parag. 258)… Les dimensions du temps, le présent, le futur et le passé, sont le devenir de l’extériorité et sa résolution dans les différences de l’être en tant que passage au néant et du néant à l’être. La disparition immédiate de ces différences dans l’individualité, c’est le présent, comme actuel qui en tant qu’individualité est exclusif, et qui en même temps se continuant dans les autres moments, n’est lui-même que cette disparition de son être dans le néant et du néant dans son être (§ 259). » a) Il faut donc dire que la durée ne va pas du passé au présent, mais que le temps vient au présent, à partir du futur, il y a donc une dimension prévalente du temps, un avenir qui est en quelque sorte antérieur au passé. En se niant comme avenir l’avenir devient maintenant, il s’accomplit dans le présent qu’il supprime, il s’oppose au futur qu’il était et n’est plus, au passé qu’il sera et n’est pas encore. Le temps est donc l’extase de lui-même. b) Ce ne sont pas les choses qui sont dans le temps mais c’est le temps lui-même qui est l’étoffe des choses. Cézanne dira des objets qu’ils sont des accidents de la lumière on pourrait dire que, pour Hegel, les choses sont des accidents, c’est-à-dire des moments du temps. C’est le temps qui devient chose, et qui, en tant que tel, se spatialise ; l’espace est du temps paralysé, du temps achevé et accompli. c) Cette relation du temps et de l’espace nous met sur le chemin de la réconciliation. Le fait d’être séparé n’est pas une propriété du temps, elle est une propriété de l’espace qui l’accompagne. Car le temps n’est pas une séparation indifférente des moments, il est cette contradiction qui possède dans une unité immédiate ce qui est purement et complètement opposé: «C’est nous qui sommes l’espace, c’est nous qui sommes le temps qui meut les négativités de l’espace de telle façon qu’elles sont ses dimensions et leurs positions différentes. » Par conséquent temps et espace ne peuvent pas être séparés, par conséquent esprit et nature ne peuvent l’être davantage. Ils se réalisent réciproquement dans leur union dialectique. Il n’y a pas de temps non spatial, et pas d’espace intemporel, il n’y a pas non plus de nature non spiritualisée ni d’esprit non naturé. Ainsi «la tâche de la philosophie consiste à concilier… à poser l’être dans le non-être – comme devenir – la scission dans l’Absolu comme son phénomène – le fini dans l’Infini, comme sa vie ».
L’aliénation de l’Absolu dans le devenir est donc l’expression de son auto-genèse ; la scission de l’Absolu ressemble aux douleurs de l’enfantement; cette scission est une position qui est une ex-position. La réconciliation pourra donc être rapprochée de la remontée à la Droite du Père dont parle le christianisme. Le Oui de la réconciliation, c’est Dieu se manifestant dans la séparation et dans l’aliénation : « Grâce à cette aliénation, ce savoir scindé dans son être-là retourne dans l’unité du Soi, est le moi effectif, le savoir universel de soi-même dans son contraire absolu, dans le savoir étant-au-dedans de soi, qui en vertu de la pureté de son être-au-dedans-de-soi séparé est lui-même le parfaitement universel. Le Oui de la réconciliation, dans lequel les deux Moi se désistent de leur être-là opposé, est l’être-là du Moi étendu jusqu’à la dualité, Moi qui en cela reste égal à moi-même, et qui dans sa complète aliénation et dans son contraire complet a la certitude de soi-même, – il est le Dieu se manifestant au milieu d’eux qui se savent comme le pur savoir » (Phénomé. Il, p. 200). Le Temps est donc le théâtre de la Parousie et du Salut, ou plutôt il est cette Parousie et ce Salut eux-mêmes. Le temps est, en effet, le Oui par lequel l’Etre se pose, ce qui assure la réconciliation du singulier et de l’universel. Il faut donc dire « Oui » à ce « oui » du temps. Donc Fatum = Amor, et Sagesse = Amor Fati.
Aliénation (Entäusserung) Réconciliation et Religion
Le texte central se trouve dans Philosophie de la Religion t. IV, pp. 128-166, d’où nous extrayons les passages principaux : « La nature divine et la nature humaine en soi ne sont pas différentes : Dieu se manifeste sous forme humaine … Cette détermination que Dieu devient homme afin que l’esprit fini ait dans le monde fini conscience de Dieu est le moment de la religion le plus grave (p. 134) … Dieu c’est l’Esprit vivant qui se différencie, pose l’Autre, en restant identique à cet Autre, en ayant en lui son identité en soi. Voilà la vérité (p. 136) … L’aliénation suprême de l’Idée divine : Dieu est mort, Dieu lui-même est mort, est une représentation prodigieuse, terrible, qui présente à la représentation l’abîme le plus profond de la scission. Toutefois, cette mort est aussi le plus grand amour. L’amour en effet est l’identité du divin et de l’humain, et la finitisation de la conscience est poussée à son point extrême, la mort ; on a donc ici l’intuition de l’unité à son degré absolu, l’intuition suprême de l’amour (152) … Cette mort donc, la souffrance, la douleur de la mort, est cet élément de la réconciliation de l’Esprit avec lui-même, avec ce qu’il est en soi, ce qu’il renferme (153) … Par la mort il s’est trouvé accompli que l’Idée divine s’est aliénée jusqu’à la souffrance amère de la mort et l’ignominie du malfaiteur, et que de cette manière la finité de l’homme s’est trouvée transfigurée au plus haut degré par le suprême amour. Cette finité est cette souffrance, la plus grande souffrance, celle ci est l’amour suprême, en elle est ce suprême amour (156)… Par la mort, Dieu a réconcilié le monde et se réconcilie éternellement avec lui-même. Le retour fait qu’il revient en soi, ainsi il est esprit ; le troisième point est donc la résurrection du Christ. La négation est vaincue par là et la négation de la négation devient un moment de la nature divine, le Fils est élevé à la droite de Dieu… Voici une nouvelle détermination. Dieu n’est plus en vie, Dieu est mort ; pensée la plus effroyable, donc tout ce qui est éternel, vrai, n’est pas, la négation est même en Dieu ; la douleur suprême, le sentiment de la perdition achevée, le renoncement à tout ce qui est élevé se rattachent à cela. Cependant la suite ne s’en tient pas là ; une conversion se produit; Dieu se conserve dans ce processus, lequel n’est que la mort de la mort ; Dieu revient à la vie ; cela se retourne donc en son contraire (159)… C’est Dieu qui a tué la mort puisqu’il en triomphe ; par là la finité, l’humanité, l’avilissement deviennent en Christ un élément étranger, en Christ, Dieu absolu (160) … La mort du Christ se définit comme la mort qui constitue le passage à la gloire, à la glorification qui d’ailleurs n’est que le rétablissement de la gloire primitive (163). » Ainsi donc Dieu a tué la mort puisqu’il en triomphe. On peut donc dire que le dépassement dialectique signifie à la fois aufheben (nier en dépassant), vereinigen (unir et concilier), versohnen (réconcilier) erglinzen (parachever, accomplir). Mais nous nous dirigeons tout de suite par là vers les thèmes éthiques et politiques. Hegel affirme, en effet, que « l’Esprit peut faire que ce qui a été fait ne le soit pas, l’action demeure bien dans le souvenir, mais l’Esprit l’efface » (IV 165). En effet, la loi et le châtiment sont supprimés et dépassés dans la réconciliation avec le Destin (cf. L’Esprit du christianisme … p. 48), c’est pourquoi Hegel écrit : « Les blessures de l’Esprit se guérissent sans laisser de cicatrices» (Phénomé. Il, 197), car par l’aliénation, Dieu sort de soi et par la réconciliation il retourne en soi ; de toute façon il se manifeste. Par conséquent : « Le mot de la réconciliation est l’objet étant-là qui contemple le pur savoir de soi-même comme singularité qui est absolument au-dedans de soi, une reconnaissance réciproque qui est l’esprit absolu» (Phénomé. II, 198).
Réconciliation et histoire
On a souvent remarqué que la position de Hegel pouvait conduire à une philosophie mettant l’accent sur le savoir de soi de l’Absolu à travers l’homme, ou à une déification de l’humanité (Feuerbach, Marx). En effet, il y a dans les perspectives précédentes de quoi conduire de la théodicée à une anthropodicée. Les pages célèbres que Hegel a consacrées à Antigone (Phénomé. Il, 15 sq) soulignent la contradiction qui existe au cœur de la cité antique. En elle se trouvent, en effet, la loi humaine (loi du jour, lois explicites de la cité) et la loi divine (les Pénates, la famille, la passion de la nuit et la profondeur du souterrain). Créon incarne la première et Antigone la seconde. Dans l’Antigone de Sophocle, nous assistons à un affrontement de ces deux lois: Créon ne veut pas que l’on donne une sépulture à Polynice qui a pris les armes contre sa patrie, Antigone veut ensevelir la dépouille de son frère. Finalement les Pénates (Antigone) sont vaincus par la Cité (Créon). Le tragique c’est la coexistence de ces deux volontés, le Destin c’est la conscience de ce tragique. Mais, ici aussi, du drame naît la réconciliation ; à la fin des Euménides d’Eschyle, les Erinyes se transforment en Euménides, le crime est dépassé, pardonné, grâce à l’instrument de justice créé par l’Etat athénien. Ainsi la réconciliation (Versohnung) est une rémission (Vergebung). Il faut donc parler d’un rôle moteur de l’Etat qui concilie en lui l’universel et le singulier, mais aussi un rôle moteur de la guerre qui permet de passer des cités à l’empire. Si bien que Hegel n’hésite pas à écrire que « pour ne pas laisser se désagréger le tout et s’évaporer l’esprit, le gouvernement doit de temps en temps les ébranler dans leur intimité par la guerre » (Phénomé. II, 23). Aux individus il doit «donner à sentir leur maître: la mort» (ibid.). Telle est la raison pour laquelle on trouve chez Hegel une certaine apologie de la guerre : « La guerre a cette signification supérieure que par elle… la santé morale des peuples est maintenue dans son indifférence en face de la fixation des spécificités finies, de même que les vents protègent la mer contre la paresse où la plongerait une tranquillité durable, comme une paix durable ou éternelle y plongerait les peuples … Les guerres heureuses empêchent les troubles intérieurs et consolident la puissance intérieure de l’Etat » (Principes de la philosophie du droit, § 324). Nous voyons donc que l’histoire revêt chez Hegel une portée eschatologique dans la mesure où aujourd’hui nous sauve d’hier, tout comme demain nous guérira d’aujourd’hui ; le futur y joue le rôle, dialectique, que la rémission des péchés joue dans le christianisme. Ainsi donc il n’y a pas, à la limite, des crimes de l’histoire mais des crimes contre l’histoire. En effet, « l’histoire de l’esprit, c’est son action, car il n’est que ce qu’il fait, et son action, c’est de faire de soi-même, et cela en tant qu’il est esprit, l’objet de sa conscience, se concevoir soi-même en se comprenant » (loc. cit., § 343) ; « l’histoire est l’incarnation de l’esprit sous la forme de l’événement» (§ 346). La loi du « Meurs et Deviens » fait de l’histoire l’instrument de libération de l’individualité et du mal.
L’Etat et la réconciliation
La réconciliation nous a conduit à nouveau à l’histoire ; l’histoire va nous conduire à l’Etat. On a souvent dit que l’Etat dont parlait Hegel était l’Etat prussien dont il était le contemporain, mais Eric Weil a bien montré (Hegel et l’Etat) que l’Etat dont parlait Hegel n’était pas tel ou tel Etat, mais l’Etat historico-dialectique. Nous savons que l’histoire est rationnelle parce que la raison est historique ; on peut donc dire que « ce qui est rationnel est réel et ce qui est réel est rationnel». (Pps de la philo. du droit, préface, p. 30). En effet, l’histoire universelle n’est autre chose que l’extériorisation de l’Esprit dans le temps, comme l’idée en tant que Nature s’extériorise dans l’espace. Ainsi «l’esprit s’oppose à lui-même en soi ; il est pour lui-même le véritable obstacle hostile qu’il doit vaincre ; l’évolution, calme production de la nature, constitue pour l’esprit une lutte dure, infinie contre lui-même. Ce que l’esprit veut, c’est atteindre son propre concept ; mais lui-même se le cache et, dans cette aliénation de soi-même, il se veut fier et plein de joie (Philo. de l’hist., p. 51). Or, qu’est-ce que l’Etat?« L’Etat, comme réalité en acte de la volonté substantielle, réalité qu’elle reçoit dans la conscience particulière de soi universalisée, est le rationnel en soi et pour soi : cette unité substantielle est un but propre absolu, immobile, dans lequel la liberté obtient sa valeur suprême, et ainsi ce but final a un droit souverain vis-à-vis des individus dont le plus haut devoir est d’être membres de l’Etat» (Philo. du droit, § 258). L’Etat n’est donc pas ce que les définitions juridiques en font, il n’est pas destiné à assurer la sécurité et la propriété personnelles, il est l’esprit objectif, et c’est pourquoi l’individu n’a de vérité et de moralité que s’il en est un membre. D’où le paragraphe 262 qui est capital : « L’idée réelle en acte ou esprit qui se divise soi-même dans les deux sphères idéelles de ce concept : la famille et la société civile qui constituent son aspect fini, tend à sortir de leur idéalité pour soi et à devenir esprit réel infini, et alors il répartit dans ces sphères le matériel de cette réalité finie i. e. qu’il répartit les individus comme les masses, si bien que cette attribution semble produite pour chaque particulier par les circonstances, le libre-arbitre et le choix personnel de la destinée. » L’Etat possède donc une réalité organique qu’il faut protéger, car il est la Raison actualisée dans l’Esprit d’un peuple, et c’est dans cette réalité organico-spirituelle de l’esprit d’un peuple que les individus se trouvent libérés de leur individualité finie et réconciliés dans une réalité plus haute. Nous retrouvons donc là, au niveau de l’Etat, le thème de la Ruse de la Raison déjà rencontré à propos du Grand Homme : « Les Etats, les peuples et les individus, dans cette marche de l’esprit universel, se lèvent chacun dans son principe particulier bien défini qui s’exprime dans sa constitution et se réalise dans le développement de sa situation historique: ils ont conscience de ce principe et s’absorbent dans son intérêt, mais en même temps ils sont des instruments inconscients et des moments de cette activité interne dans laquelle les formes particulières disparaissent tandis que l’esprit en soi et pour soi se prépare un passage à son degré immédiatement supérieur » (Philo. du droit, § 344). C’est ainsi que se développe la théorie du droit organique. Hegel se place en effet aux antipodes des conceptions chères au XVIIIe qui avait parlé d’un droit naturel déduit des dispositions innées de l’homme. La déclaration des droits de l’homme et du citoyen était partie d’un certain nombre d’a priori moraux. Kant lui-même avait vu dans le droit ce qui permettait à la moralité de s’exercer et qui donc, bien loin de la faire, la supposait. Hegel refuse les a priorismes éthiques, refuse l’idée même d’un droit international ou d’une association d’Etats ; en effet, il s’agit là, pour lui, de notions qui sont sans réalité puisqu’elles n’ont jamais reçu la consécration de l’histoire. Pour Hegel, le Droit et l’Etat ne résultent pas de la nature immédiate de l’homme : ils l’en délivrent. C’est pourquoi l’Etat, incarnation de l’Esprit comme réalité historique concrète, est un hyperindividu auquel les individus doivent se soumettre sans chercher à le faire : « Ainsi l’Etat sait ce qu’il veut et le sait dans son universalité, comme quelque chose de pensé, donc il agit et se comporte d’après des buts connus, des principes explicites, et d’après des règles qui sont non seulement des règles en soi, mais aussi pour la conscience ; et de même, si ses actions ont rapport à des circonstances ou à des situations données, il tient compte de la connaissance qu’il en a >> (Philo. du droit, § 270). li est donc nécessaire de respecter l’Etat, et les lois ne sont pas faites pour protéger les individus de l’Etat, mais bien pour protéger l’Etat des individus qui s’alièneraient dans quelque individualisme de la licence. C’est pourquoi «Définir la liberté de la presse comme la liberté de dire et d’écrire ce que l’on veut est parallèle à la définition de la liberté comme liberté de faire ce que l’on veut… Il existe des violations de l’honneur des individus en général : calomnies, injures, diffamations du gouvernement, de ses autorités, des fonctionnaires, de la personne du prince en particulier, dérision des lois, excitation à la révolte, au crime, au délit, avec les nuances les plus variées» (Philo. du droit, §319). Hegel n’hésite pas à comparer le délit d’opinion au non respect de la vérité scientifique : « De même que l’expression scientifique a son droit et sa garantie dans sa matière et son contenu, de même le délit d’expression peut être permis ou du moins être supporté grâce au mépris où il s’est placé» (§ 319).
Conclusion
Le problème essentiel pour Hegel était de se rapprocher de Dieu, mais de s’en rapprocher autrement qu’en s’arrachant au monde. En convergeant dans la notion de Dieu Vivant, l’histoire, le savoir, le concept, lui ont donné la possibilité de poser le problème de la réconciliation sur le plan de la cité. Nous n’avons pu suivre la pensée de Hegel dans le déroulement des voies de son Esthétique, mais nous y aurions vérifié que le but de chaque art consiste à offrir à notre intuition l’identité réalisée par l’esprit, de l’éternel, du divin, du vrai en soi et pour soi à travers leurs manifestations réelles et leurs formes concrètes. L’art n’est donc pas un jeu mais « une libération de l’Esprit du contenu et de la forme de la finitude ; il s’agit de la présence de l’Absolu dans le sensible et le réel, de sa conciliation avec l’un et l’autre, de l’épanouissement de la vérité dans l’histoire universelle où nous pouvons retrouver la plus belle et la plus haute récompense pour les durs travaux dans le réel et les pénibles efforts de connaître » (dernière page de l’Esthétique) ; là aussi Hegel a voulu suivre le «concept fondamental du beau et de l’art à travers tous les stades qu’il parcourt dans sa réalisation». Finalement, l’histoire universelle n’est autre chose que l’évolution du concept de liberté (cf. Philo. de l’hist., pp. 28, 56, 346), et la philosophie n’a affaire qu’à l’éclat de l’Idée, qui se reflète dans l’histoire universelle. L’aliénation c’est l’attention exclusive à l’être-là ; la réconciliation c’est la compréhension du passage, du dépassement et du devenir par lequel Dieu se fait : « L’histoire universelle est … le devenir réel de l’Esprit sur le théâtre changeant de ses histoires ; c’est là la véritable Théodicée, la justification de Dieu dans l’histoire. La seule lumière qui puisse réconcilier l’esprit avec l’histoire universelle et avec la réalité, est la certitude que ce qui est arrivé et arrive tous les jours, non seulement ne se fait pas sans Dieu, mais est essentiellement son œuvre» (fin de la Philo. de l’histoire). Il est à peine besoin de souligner l’importance de la pensée de Hegel dans l’histoire des idées. Rappelons qu’elle donna naissance à un hégélianisme de droite, faisant l’apologie nationaliste de l’Etat, et à un hégélianisme de gauche qui, avec Feuerbach puis Marx, verra dans l’histoire, non pas l’incarnation de Dieu, mais celle de l’homme. Parmi les multiples problèmes posés par le hégélianisme et sur lesquels la réflexion critique peut s’exercer, indiquons brièvement ceux-ci :
1. La théodicée de Hegel ne met-elle pas entre parenthèses une notion chrétienne essentielle, celle du Dieu personnel? En ce sens, l’antidote de Hegel est Kierkegaard, plus précisément son Post-scriptum non scientifique aux Miettes philosophiques.
2. Peut-on faire de l’histoire le facteur de réconciliation et de rédemption en affirmant que les blessures de l’Esprit se guérissent sans laisser de cicatrices, ou faut-il dire qu’un crime reste un crime et que la vertu dialectique de l’histoire ne peut le changer en bien? Est-ce à l’histoire de nous juger ou à nous de juger l’histoire ?
3. Si les lois sont faites pour protéger l’Etat de l’individu, ne faut-il pas également des lois pour protéger l’individu de l’Etat ?
4. Que dire de ce Grand Homme (qu’il soit de droite ou de gauche) qui incarne l’Esprit d’un peuple et à qui Hegel va jusqu’à reconnaître le droit de fonder des Etats (Philo. du droit, § 350) ?
5. L’existence est-elle un système?
6. Le Sens est-il ce qui se fait dans et par l’histoire, ou l’histoire est-elle à l’intérieur d’un sens qu’elle recherche mais auquel elle est toujours inadéquate ?
7. La Cité des hommes dont parle Hegel ne fera-t-elle qu’un avec la Cité de Dieu, et faut-il modifier la parole des Ecritures en disant « Mon Royaume n’est pas encore de ce monde»?
Nous pourrions dire, finalement, que les difficultés, voire les ambiguïtés, du hégélianisme viennent de ce que
l’on y parle successivement ou simultanément deux langages : celui selon lequel c’est l’Histoire qui fait l’Absolu et celui selon lequel c’est l’Absolu qui fait l’Histoire.
A ceux qui ne connaîtraient pas Hegel et qui voudraient s’initier à la lecture de ce philosophe, nous recommandons la lecture de La Raison dans l’Histoire, livre bref et clair dans lequel Hegel s’est résumé lui-même ; on pourra compléter cette lecture par celle de la Préface à la Phénoménologie de l’Esprit. Dans L’Essence du christianisme, Feuerbach tirera de la lecture de Hegel la conclusion qu’« il n’y a pas d’autre dieu pour l’homme que l’homme luimême», conclusion que de nombreux théologiens contemporains reprennent implicitement à leur compte. Une critique de Hegel et de Feuerbach se trouve dans L’Ecole du christianisme, de Kierkegaard.