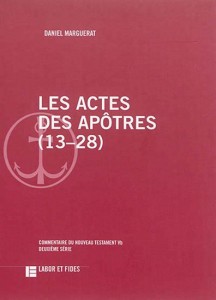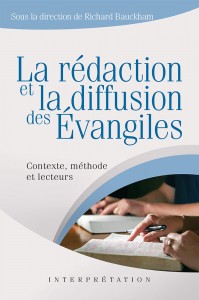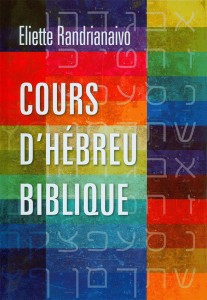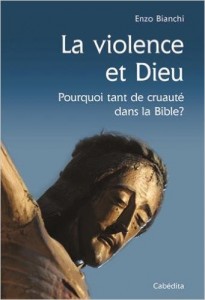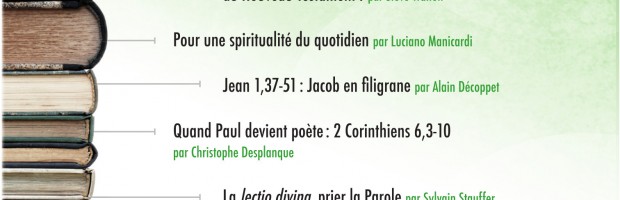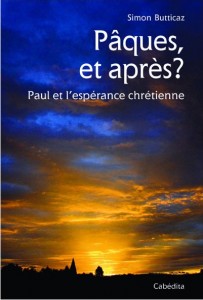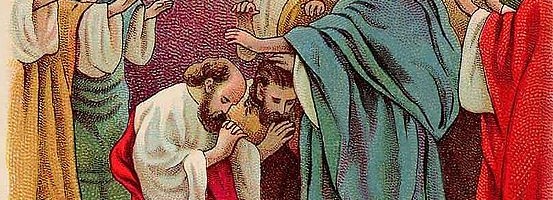Le quotidien comme catastrophe
« Tels furent les jours de Noé, tel sera l’avènement du Fils de l’homme ; car de même qu’en ces jours d’avant le déluge, on mangeait et on buvait, l’on se mariait ou l’on donnait en mariage, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche, et on ne se doutait de rien jusqu’à ce que vînt le déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l’avènement du Fils de l’homme » (Mt 24,37-39). Avant de se noyer dans le déluge, la génération de Noé, si l’on en croit le texte matthéen, s’est noyée dans sa propre inconscience, dans la non-vigilance, dans l’inattention face à ce qui se préparait. Elle s’est noyée dans un quotidien devenu l’horizon totalisant et assourdissant, capable d’étourdir et d’abrutir, parce que vécu de manière inconsciente. Selon Matthieu, cette génération n’est pas accusée d’une méchanceté particulière, mais de ne s’être rendu compte de rien, de n’avoir rien compris.
La version lucanienne de cet épisode complète le cadre du quotidien de la génération de Noé par la dimension du travail : « On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait » (Lc 17,28). Bien entendu, manger et boire, se marier et avoir des enfants, faire du commerce et travailler la terre, tout comme les autres éléments qui constituent l’ossature de la vie quotidienne, n’est en rien répréhensible. Toutefois, le texte nous interpelle sur la possibilité de vivre sans vivre, de vivre sans savoir pourquoi, de vivre de manière inconsciente. Une telle vie, qui constitue –toujours- une possibilité pour chacun, et qui n’est certes pas une prérogative de la génération de Noé, se vérifie quand ce qui est vécu de manière extérieure n’est pas revécu intérieurement ; quand on s’arrête au niveau du fait divers et qu’on se soustrait au travail en profondeur de l’interprétation, quand on se jette dans les bras du démon de la facilité et qu’on se refuse au labeur, à ce qui est difficile. On vit alors comme le fils cadet de la parabole lucanienne : de manière insensée, loin du salut (asôtôs : Lc 15,13), en se fuyant soi-même. On vit hors de soi, à tel point que pour retrouver sa propre existence, le jeune de la parabole devra « rentrer en lui-même » (Lc 15,17).
Ce n’est pas dans la profondeur que l’on se noie, mais dans la superficialité. La catastrophe d’une existence peut se dissimuler dans les plis apparemment inoffensifs du quotidien. Vivre spirituellement le quotidien signifie donc être présent à soi-même, être complètement dans ce que l’on fait, habiter les paroles que l’on prononce, en un mot : devenir conscient, ou pour utiliser le langage de l’Évangile : être vigilant.
La vigilance
Vivre le quotidien dans la foi exige que l’on assume l’attitude de la vigilance, centrale dans le Nouveau Testament (Mc 13,37 ; Mt 24,42-44.45-50 ; 25,1-13 ; Lc 21,34-36 ; 1 Co 16,13 ; Col 4,2 ; 1 Th 5,6 ; 1 Pi 5,8 ; etc.). Il s’agit d’une attitude globale de l’homme, une attention à la présence du Seigneur, une tension intérieure pour discerner sa proximité, une ouverture radicale de tout l’être à sa venue. Puisqu’elle est centrée sur le Seigneur qui est venu, qui vient et qui viendra, elle devient une attention au temps et à l’histoire, au corps et à la parole, à soi et aux autres, en un mot : à tout ; et elle modèle une personne qui adhère à la réalité, qui ne considère plus que les choses vont de soi, qui fuit la superficialité et la banalité, qui se laisse interpeller et étonner par tout. La personne vigilante est lucide, critique, modérée, présente à elle-même et aux autres, à tout ce qui vit.
La vigilance est l’attitude de celui qui reste éveillé et ne se laisse pas étourdir par la répétitivité dont le quotidien est tissé. Il n’est pas étonnant qu’un père du désert, Abba Poemen, ait pu affirmer que « nous n’avons besoin que d’un esprit en éveil »1 et que Basile de Césarée ait conclu ses Règles morales, adressées à tout chrétien et non réservées aux moines, par un portrait du chrétien qui s’achève précisément sur la vigilance. « Qu’est-ce qui est le propre du chrétien ? C’est de veiller à toute heure du jour et de la nuit et de se tenir prêt dans la perfection qui plaît à Dieu, car il sait que le Seigneur vient à l’heure à laquelle il ne pense pas »2. Cette page de saint Basile dessine un itinéraire catéchétique qui, en partant de l’écoute de la Parole de Dieu qui engendre la foi, et en passant par le baptême qui marque la renaissance d’en-haut du chrétien et l’introduit dans le corps ecclésial, et l’eucharistie, qui l’amène à vivre non pour soi-même mais pour le Christ, en faisant quotidiennement mémoire de lui grâce à la vigilance, parvient précisément à la vigilance, pilier soutenant l’édifice tout entier de la vie chrétienne.
De quoi le quotidien est-il fait ?
Pour parler du quotidien, il faut avant tout le voir et le nommer. Puisqu’il s’agit de ce dans quoi l’homme est immergé et de quoi il est constamment contemporain, le quotidien est peu visible et reconnaissable. Le quotidien, c’est la vie telle que nous la percevons normalement. Ce qui le révèle, en effet, est également ce qui le cache. Et en particulier la répétitivité. Tout ce qui est vital doit être répété quotidiennement, mais ce qui est répété est aussi exécuté mécaniquement, sans qu’on y pense, inconsciemment. Assurément, il faut rester attentif lorsqu’on se rase la barbe le matin ; mais le quotidien est tissé d’une quantité de gestes mémorisés et presque automatiques, que rend supportables précisément le fait qu’ils ne doivent pas être objets de réflexion ou de décision : le rite matinal du petit déjeuner, le parcours pour aller au travail et en revenir, les gestes toujours identiques de la vendeuse du supermarché, etc. Le quotidien est ensuite constitué d’une série d’actes « humains » élémentaires comme manger, dormir, travailler, se reposer, parler, etc. Mais on devrait aller plus en profondeur, voire plus dans le détail, et redécouvrir que font partie du quotidien également des gestes comme celui de se préparer un café, de faire une promenade, de contempler un coucher de soleil, de faire la cuisine, de sortir sur le balcon, de lire un journal ou un livre, de saluer ceux que l’on rencontre, de s’entretenir avec une connaissance, de jouer avec son chien, de rire ou de pleurer, de plaisanter ou de s’énerver, d’acheter des vêtements, d’entrer dans un magasin… Et nous devrions encore ajouter le quotidien contemporain, à savoir les éléments qui rendent notre quotidien différent de celui d’il y a quelques années ou décennies : regarder la télévision, naviguer sur Internet, téléphoner avec un portable, utiliser un « téléphone intelligent », un iPad, prendre un avion, etc. Nous sommes face à une technologisation du quotidien : c’est un quotidien à l’épreuve d’Internet.
La question que nous devrions nous poser est celle-ci : que faisons-nous de ce quotidien ? Ou mieux, que faisons-nous de nous-mêmes à travers lui ? Mais plus souvent, nous devons nous arrêter sur la question, qui arrive toujours tard : qu’a-t-il fait de nous ? Comment nous a-t-il transformés ? Qui sommes-nous devenus ? C’est dans la non-vigilance, dans l’accumulation d’heures de vie inconsciente de soi que se cache la banalité du mal et que se prépare la ruine d’une existence personnelle. Deux questions se posent : quels sont les éléments qui doivent contribuer à composer la physionomie d’une « spiritualité » du quotidien ? Et : quel fondement peut inspirer une approche spirituelle chrétienne du quotidien ?
Pour une physionomie spirituelle du quotidien
La vie comme ascèse
Rien n’existe en dehors du quotidien. C’est pourquoi celui-ci exige obéissance et rébellion, sympathie et prise de distance. Le vivre spirituellement signifie le comprendre comme une invitation à aller en profondeur, à entrer dans sa propre intériorité, à habiter son humanité pour inventer des pratiques quotidiennes illuminées par le sens et habitées de gratuité. C’est ainsi que peut s’unifier la multiplicité même du quotidien : le quotidien du rapport avec la nature, le quotidien du travail, le quotidien de la vie en famille, le quotidien des rapports sociaux… Les premières lignes d’un très beau livre d’Emanuele Trevi expriment avec limpidité une approche « spirituelle » d’un phénomène naturel quotidien, le coucher de soleil :
Cher Marco, peut-on faire le compte-rendu d’un coucher de soleil ? Ce soir de décembre, aiguisé par la tramontane, vient d’achever l’exécution de sa géniale série de variations sur les thèmes du rouge-pourpre et du lilas. Apparemment, personne dans les alentours ne semble avoir mérité une telle débauche princière de beauté. Tout au moins, face à ces virtuosités de l’apparence, je me sens un peu dans une situation abusive. Mon sentiment de la Nature est celui d’une personne qui voyage en autobus sans billet : plaisir d’un transport rapide et indolore, attente ineffable du châtiment3.
Capacité de voir, de s’étonner de ce que l’on voit, sens de la gratuité, reflet intérieur du paysage extérieur, dialogue avec le monde extérieur, réponse à ce que l’on a vu, implication personnelle : tous ces éléments entrent dans la configuration d’une posture spirituelle à l’égard d’un élément quotidien. Et ils nous renvoient à l’attitude de la créativité.
La créativité
La créativité est une attitude existentielle, une modalité possible à chacun de se rapporter au monde, c’est un élément que toute personne peut cultiver4. Elle consiste essentiellement dans la capacité de voir et de répondre. Ce qui signifie adhésion à la réalité et lucidité. Le rapport au quotidien nous pose la question de savoir si nous sommes véritablement capables de voir (et non seulement de regarder), si nous sommes capables de répondre à ce qui nous entoure et nous parle : savons-nous écouter le langage des choses, les questions que les réalités nous posent ?
La personne créative se meut dans le monde comme on entre dans un dialogue incessant avec tout et avec tous : elle dialogue avec les arbres et les maisons, elle se laisse interpeller par la couleur du raisin et par les bizarreries du climat, par les comportements d’un animal et par des événements qui sembleraient insignifiants. Rien pour elle ne va de soi. De la créativité fait constitutivement partie la capacité d’étonnement, de rester émerveillé. Mais également celle de rester blessé, indigné, scandalisé par les injustices que le monde présente. La capacité de concentration en fait également partie. Nous sommes toujours jetés hors de nous-mêmes par trop de stimulations, par l’excès de choses qui nous habitent. La concentration est la capacité d’être dans ce que l’on fait. La créativité, à ce point capable de créer le futur, est une réalité extrêmement présente au moment présent. Le respect de l’originalité propre de chacun fait partie d’elle. C’est-à-dire le fait d’être vraiment sujet de ses actes et de ses idées, de ne pas se « laisser agir » par d’autres instances, de ne pas se laisser manipuler. Il s’agit d’être soi-même pour ne pas céder au conformisme, qui est l’attitude contraire de la créativité et laisse la personne non dans la joie mais dans la frustration. Une autre condition de la créativité est l’acceptation des conflits, l’accueil des tensions qui dérivent des polarités. Les conflits sont une source d’émerveillement, de croissance, d’expérience réelle, un lieu de formation de ce qui jadis s’appelait « le caractère ». On se forme en se heurtant avec une réalité qui fait souffrir, avec les résistances que la réalité et les autres nous opposent.
En bref, la créativité est la disposition de la personne à naître à elle-même, à naître chaque jour. La naissance ne se limite pas à un moment précis du passé, mais le développement biologique nous dit aussi que la naissance s’accomplit en de nombreuses phases qui nécessitent des détachements pour permettre des attachements ultérieurs et toujours nouveaux. Erich Fromm a écrit : « être créatif signifie considérer tout le processus vital comme un processus de naissance, et ne pas interpréter chaque phase de la vie comme une phase finale. Beaucoup meurent sans être nés complètement. La créativité signifie avoir porté à terme sa propre naissance avant de mourir. »5
Le courage
Si la créativité ainsi comprise n’est pas réservée à quelques-uns, elle exige toutefois de tous une attitude de courage6. Le courage d’être soi-même, de fuir l’homologation et le conformisme, le courage de la solitude, de faire différemment des autres, d’abandonner les sécurités et les certitudes comme Abraham qui quitta la maison de son père et sa terre pour partir vers un lieu inconnu, le courage de tendre toujours à la vérité de ses actes et de ses paroles. Le courage est la capacité de faire commencer quelque chose même quand il y a des difficultés et des oppositions. Il crée le futur parce qu’il ose commencer : c’est la vertu du commencement qui coïncide avec une décision contestée. L’action courageuse est toujours risquée, exposée au danger, et une société comme la nôtre, qui multiplie les systèmes d’assurance, qui veut éliminer le risque et cherche la sécurité à tout prix, est également une société qui expulse le courage de l’agir humain, qui le rend non nécessaire.
Le courage montre que l’homme est capable de transcendance, qu’il peut avoir pour but non seulement son propre bien-être, mais sait mettre sa vie en jeu pour d’autres. Dans la tradition latine il est appelé fortitudo : le courage est force et volonté de décider dans la nuit, mais la décision courageuse nous saisit comme une illumination, comme une révélation. C’est un geste qui se produit dans la nuit mais qui a la force créative d’un fiat lux, d’un phare qui indique la direction et la route à suivre. Le geste courageux de personnes qui risquent leur vie ou la perdent en tentant d’en sauver d’autres nous frappe comme un éclat de vérité et comme une révélation, au cœur du quotidien, sur le sens de la vie. Le courage montre que celui qui a un motif pour mourir a également un motif pour vivre et qu’il ne place pas la prolongation biologique de ses années au-dessus de tout.
Le courage est la capacité de dire « non », de fuir les comportements grégaires, de désobéir à tout ce qui diminue et avilit l’humain. Le courage est également un geste de rupture, c’est un exercice de liberté, mais responsable, qui peut alors devenir capable d’articuler liberté et devoir. Il s’agit de prendre en charge l’acte courageux comme devoir propre, pour lui donner une continuité au cours du temps. Si le courage est la vertu du commencement, il est aussi appelé à devenir une attitude de persévérance, quotidienne. La personne courageuse est souvent celle qui fait son devoir avec honnêteté et rigueur, sans compromis et sans céder. Aujourd’hui, dans un climat social d’illégalité diffuse, de vulgarité dominante, de mépris des lois, de ruse érigée en système, le courage est le courage de la normalité. C’est à la fois le courage de ne pas fléchir face à son devoir, si ce dernier comporte l’inimitié des puissants du moment, et le « courage d’être »7, d’être à la hauteur de sa propre humanité. Le courage forge ainsi, jour après jour, des personnes tenaces, fidèles, résistantes, persévérantes. Oui, « l’homme est “l’être qui peut dire non”, “l’ascète de la vie”, et à l’égard de tout ce qui n’est que réalité l’éternel protestant »8.
L’otium : pour une sagesse du quotidien
Sympathie et distance à l’égard du quotidien exigent enfin, comme attitude spirituelle de base, l’otium (l’« oisiveté », le « loisir »). Pourquoi ? À quelle fin ? Lisons un passage de Thomas Stearns Eliot :
Où est la Vie que nous avons perdue en la vivant ?
Où est la Sagesse que nous avons perdue dans la connaissance ?
Où est la connaissance que nous avons perdue dans l’information ?9
Vie, sagesse, connaissance, information : en partant de la fin, de l’information, les mots d’Eliot dessinent un climax. Il parle d’une perte dont nous faisons l’expérience. Une perte vitale, la perte d’une vie sensée. On peut perdre la vie en la vivant. Souvent nous sommes désorientés et égarés.
Dans le contexte actuel d’idolâtrie de la communication, nous sommes étouffés par trop d’information, que nous ne savons pas élaborer. Il faudrait un mouvement de prise de distance de soi. « Il faut enseigner et apprendre à savoir se distancier, savoir s’objectiver, savoir s’accepter. Il faudrait aussi savoir méditer et réfléchir afin de ne pas subir cette pluie d’informations nous tombant sur la tête, chassée elle-même par la pluie du lendemain et ainsi sans trêve, ce qui ne nous permet pas de méditer sur l’événement présenté au jour le jour, ne nous permet pas de le contextualiser et de le situer. Réfléchir, c’est essayer, une fois que l’on a pu contextualiser, de comprendre, de voir quel peut être le sens, quelles peuvent être les perspectives. »10 Sans cette prise de distance nous restons prisonniers du présent, de l’immédiat, du fragmentaire ; nous ne construisons aucun avenir et nous nous trouvons nous-mêmes désintégrés, disséminés sur la terre dans un présent irrémédiable.
La connaissance se situe à un niveau supérieur par rapport à l’information. Elle suppose la réflexion et la méditation, une réélaboration rationnelle des informations, elle suppose que les données aient été reliées les unes aux autres, lues de différents points de vue, croisées jusqu’à faire sens, jusqu’à construire une signification. Toutefois, connaître est extrêmement fragile ; et souffre surtout du peu de conscience de sa propre fragilité. Nous connaissons peu la connaissance, ses mécanismes, ses dynamiques, ses erreurs, ses leurres, et nous prenons pour argent comptant ce qui sous peu se révélera caduc. Par ailleurs, la rationalité a ses délires et souffre de méprises. Notre connaissance souvent n’est pas humble, elle ne veut ou ne sait pas voir les duperies et les erreurs qui se produisent en elle. La connaissance doit intégrer le principe d’incertitude ou, pour le dire avec Edgar Morin : « La connaissance est une navigation dans un océan d’incertitudes à travers des archipels de certitudes. »11 Aujourd’hui nous avons en outre besoin d’une connaissance globale et fondamentale qui nous dise qui est un homme, en quoi consiste l’humain ; nous avons besoin que nous soit enseignée la condition humaine ; nous avons besoin d’entrer en amitié avec l’environnement où l’homme vit et grâce auquel il vit. Nous avons besoin d’un savoir non seulement technique et scientifique, parcellisé et spécialisé, mais intégré avec la vie, ami de la vie.
La sagesse, précisément, a à faire avec la vie. La sagesse est une forme de savoir nécessaire aujourd’hui, et dont nous manquons. Bibliquement, elle est l’art de s’orienter dans la vie, l’art de tenir fermement la barre du navire : « L’homme sage tiendra fermement le timon » (Pr 1,5 lxx). Cet art est à la fois politique et éducatif : c’est l’art de celui qui guide, gouverne, instruit, fait traverser, conduit. Mais c’est avant tout l’art de celui qui sait se gouverner lui-même. Un art qui s’obtient par la connaissance de soi, laborieuse et jamais achevée. Ronsart écrivait en 1561 : « Le vray commencement pour en vertu accroistre c’est (disoit Apollon) soy-mesme se cognoistre, celuy qui se cognoist est seul maistre de soi et sans avoir Royaume il est vraiment un roi. »12 En somme, la sagesse est capable d’orienter, d’ouvrir des chemins, de creuser le présent, d’illuminer une vie, de créer de l’avenir. Il en va de la sagesse, ce savoir qui nous enseignerait la grammaire de l’humain, comme de tout autre bien dont on sent la valeur lorsqu’il vient à manquer. Nous avons besoin d’une sagesse contemporaine. La sagesse est un savoir pratique, un art de l’existence qui devrait être capable d’accueillir les défis de l’époque contemporaine, et donc la connaître intimement ; mais elle devrait aussi savoir défier le contemporain, en n’hésitant pas à oser l’actualité de l’inactuel.
C’est dans ce contexte de retour ou de recréation d’une sagesse que se situe l’idée de la revalorisation de l’ancienne notion d’otium. C’est-à-dire une activité personnelle, intellectuelle, contemplative, de rapport intense avec soi et avec la réalité. Comme l’écrivait déjà saint Augustin : « Mon otium (loisir) n’est pas destiné à cultiver la paresse, mais à atteindre la sagesse. »13 Et Augustin disait cela en mettant à profit la leçon biblique : « La sagesse du scribe s’acquiert à la faveur du loisir. Celui qui a peu d’affaires à mener deviendra sage » (Si 38,24). Pour Augustin, le sommet de cette sagesse est la connaissance de Dieu : « Il est écrit : “Tenez-vous en repos, dit Dieu, et vous reconnaîtrez que c’est moi le Seigneur”(Agite otium et agnoscetis quia ego sum Dominus : Ps 46[45],11), non pas dans le repos du désœuvrement, mais le repos de la pensée (otium cogitationis), qui la libère de l’espace et du temps. »14 L’otium n’est pas paresse, mais travail intérieur, c’est-à-dire construction du fondement solide sur lequel peut s’appuyer une vie. L’Otium permet de retrouver le temps, d’habiter finalement le temps.
C’est dans cet art renouvelé de vivre intérieurement le temps que réside le secret pour habiter le quotidien et le vivre spirituellement en parvenant à connaître « la beauté de toutes les heures du jour, comme si chacune était déjà une petite éternité »15. Le temps apparaîtra alors comme le véritable temple, le lieu où il est possible de faire de l’existence une célébration du quotidien.
Fondement chrétien de l’approche spirituelle du quotidie
L’humanité de Jésus de Nazareth
Il va de soi que vivre spirituellement le quotidien, dans une perspective chrétienne, ne signifie rien d’autre que de vivre la vocation baptismale en se laissant guider par l’Esprit saint. Mais le modèle de cette vie est l’humanité de Jésus de Nazareth telle que les évangiles en offrent le témoignage. Jésus fait le récit de Dieu par sa pratique d’humanité, non à travers des rites ou des actions cultuelles, non par des lois ou des oracles, mais par l’art de la parole et du geste, par l’écoute et la compassion, par la rencontre et la relation avec les personnes. Il parle de Dieu à travers les paraboles, qui sont des récits de la normalité qui tirent leur matériau narratif et « révélatif » du quotidien : une femme dans sa cuisine, un paysan qui travaille la terre, un pêcheur qui tire ses filets à terre, un homme qui part pour un voyage, une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, un figuier…
Jésus fait le récit de Dieu en prenant des décisions et en réalisant des choix sur la base de deux critères condensés : l’obéissance à la volonté de Dieu interprétée dans la conscience que « Dieu ne veut pas la mort du pécheur mais qu’il se convertisse » (voir Ez 18,23), et que toute la Torah se résume dans le commandement d’aimer Dieu et le prochain ; et le respect radical de l’humain en tout homme, ainsi que l’œuvre de réintégration et de guérison de chacun, pécheur ou juste, sain ou malade (voir Jn 8,11 ; Lc 7,36-50).
Mais le modèle qui doit inspirer la vie quotidienne du croyant est la pratique de Jésus en tant qu’humain. Il conviendrait donc de se poser toujours cette question lorsqu’on lit les Évangiles : quelle humanité Jésus habite-t-il ? Quel homme est celui qui chasse du temple les vendeurs d’animaux pour les sacrifices, qui prononce des paroles puissantes et profondes comme les béatitudes, qui embrasse avec tendresse les enfants, qui reprend âprement ses disciples, qui adresse des invectives prophétiques aux scribes et aux pharisiens, qui interprète avec intelligence et originalité l’Écriture, qui rencontre des personnes malades et en prend soin, qui voit l’amour là où les hommes religieux ne reconnaissent que le péché (voir Lc 7,36-50), qui sait parler en public, aux foules, et qui cherche la solitude et les lieux déserts pour penser et pour prier ?
On pourrait continuer longtemps. Mais il suffit de se souvenir qu’en christianisme le rapport avec l’homme Jésus de Nazareth est essentiel en vue de connaître Dieu, et que son humanité simple et sa pratique du quotidien, telles qu’elles sont attestées dans les Évangiles, sont donc le modèle pour le croyant qui, de lui, apprend « à vivre dans ce monde » (Tt 2,12). En effet, « ce que Jésus a d’exceptionnel n’est pas d’ordre religieux, mais humain »16.
Luciano Manicardi, moine de la communauté de Bose
1� Poemen 135, dans Les sentences des pères du désert. Collection alphabétique, L. Régnault (éd.), Sablé-sur-Sarthe, Solesmes, 1981, p. 251.
2� Basile de Césarée, Règles morales 80,22, in Basile de Césarée, Les règles morales et portrait du chrétien, L. Lebé (éd.), Namur, Éditions de Maredsous, 1969.
3� E. Trevi, Istruzioni per l’uso del lupo. Lettera sulla critica, Rome, Elliot, 2012, p. 17.
4� Voir E. Fromm, « L’atteggiamento creativo », in H. H. Anderson (éd.), La creatività e le sue prospettive, Brescia, La Scuola, 1972, pp. 67-78. Traduit de : E. Fromm, “The creative attitude”. In H.H. Anderson (Ed.), Creativity and its cultivation, New York, Harper & Row, 1959, pp. 44-54.
5� E. Fromm, art. cit., p. 77.
6 Voir D. Fusaro, Coraggio, Milano, Raffaello Cortina, 2012.
7� P. Tillich, The Courage to Be, New Haven, Yale University Press, 1952 ; trad. fr.: Le courage d’être, Genève, Labor et Fides, 2014.
8� M. Scheler, La situation de l’homme dans le monde, Paris, Aubier-Montaigne, 1951, p.72.
9� T. S. Eliot, Choruses from The Rock, 1934 (extrait de la première strophe, traduit de l’anglais).
10� E. Morin, Amour, poésie, sagesse, Paris, Seuil, 1997, p. 69.
11� E. Morin, Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Paris, Seuil, 2000, p. 14.
12� Cité dans M.-M. Davy, La connaissance de soi, Paris, PUF, 1966, p. 14.
13� Otium meum non impenditur nutriendae desidiae, sed percipiendae sapientiae : Augustin, Commentaire de l’Évangile selon saint Jean 57,3.
14� Augustin, La vraie religion, Paris, Desclée de Brouwer, 1951, pp. 118s.
15� J. Guitton, « Préface » à J. H. Newman, Les Bénedictins, Paris 1980, cité dans C. Nys-Mazure, Célébration du quotidien, Paris, Desclée de Brouwer, 1997, p. 12.
16� J. Moingt, « La figure de Jésus », Didaskalia 36/2006, p. 29.
 Michel Mallèvre, Les évangéliques. Un nouveau visage du christianisme, collection « que penser de… ? », Éditions Jésuites, Namur/Paris, 2015, ISBN 978-2-87356-652-4, 9,50 €.
Michel Mallèvre, Les évangéliques. Un nouveau visage du christianisme, collection « que penser de… ? », Éditions Jésuites, Namur/Paris, 2015, ISBN 978-2-87356-652-4, 9,50 €.