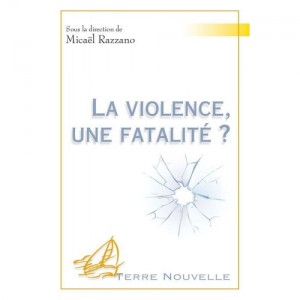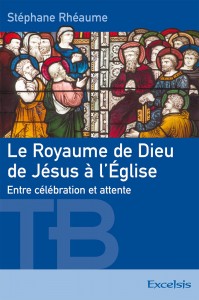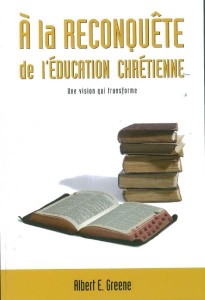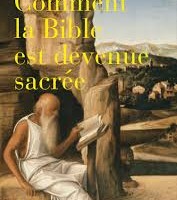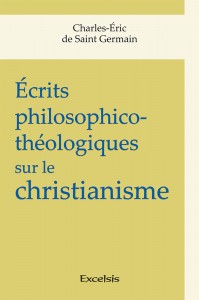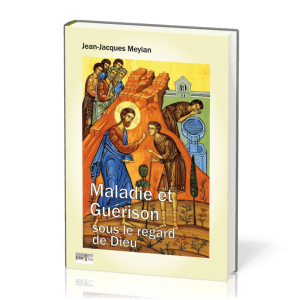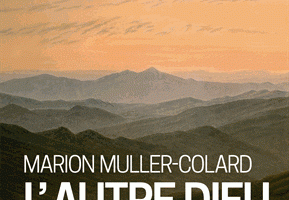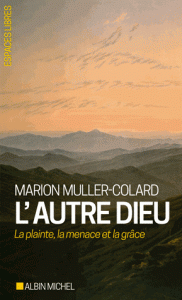Par Gérard PELLA (pasteur réformé, Attalens, Suisse) et Yvon KULL (chanoine de la congrégation religieuse du Grand-Saint-Bernard, Martigny, Suisse)
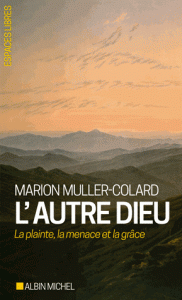 Partant d’une expérience personnelle – l’angoisse au chevet de son fils gravement malade – Marion Muller-Colard remet en question sa compréhension d’un Dieu censé nous protéger de toute menace. De son ministère pastoral en milieu hospitalier, « elle retient la plainte de patients soudain privés des repères d’un Dieu avec lequel ils croyaient pourtant avoir passé un contrat. (…) Au-delà de la plainte et de la menace, Marion Muller-Colard fait miroiter la grâce dans ce texte très incarné, composé pour tout lecteur en recherche d’une pensée théologique originale, accessible et exigeante. »
Partant d’une expérience personnelle – l’angoisse au chevet de son fils gravement malade – Marion Muller-Colard remet en question sa compréhension d’un Dieu censé nous protéger de toute menace. De son ministère pastoral en milieu hospitalier, « elle retient la plainte de patients soudain privés des repères d’un Dieu avec lequel ils croyaient pourtant avoir passé un contrat. (…) Au-delà de la plainte et de la menace, Marion Muller-Colard fait miroiter la grâce dans ce texte très incarné, composé pour tout lecteur en recherche d’une pensée théologique originale, accessible et exigeante. »
Couronné du Prix Spiritualités d’Aujourd’hui et du Prix Ecritures & Spiritualités en 2015, le livre de Marion Muller-Colard a été reçu avec enthousiasme par la plupart des lecteurs. Il faut donc beaucoup de témérité pour oser écrire un écho critique, comme nous allons le faire. Avant cela, soulignons les aspects positifs de cet ouvrage :
- son style très soigné. Marion Muller-Colard a trouvé des formules magnifiques pour exprimer sa pensée. Les extraits que nous allons citer en donneront un aperçu.
- sa dénonciation d’un Dieu contractuel, censé nous protéger si nous respectons notre part du contrat : « Job a perdu la confiance en ce Dieu contractuel qui protégeait sa vie » (p. 52) ; « la piété ne protège de rien » (p. 55).
- sa grande authenticité. Marion Muller-Colard ne cache pas sa détresse et ses tâtonnements : « Fâchée avec mon Dieu imaginaire qui avait rompu sans préavis mon contrat inconscient de protection, je manquais de secours spirituel. Je ne trouvais pas de prière qui puisse être autre chose qu’une immense contradiction, une négociation régressive avec la peau morte d’un Dieu qui ne tenait pas » (p. 82).
- une articulation réussie entre autobiographie et réflexion théologique. L’auteure nous permet de comprendre comment la maladie de son fils a remis en cause sa théologie : « Pour ma part, j’avais perdu l’insouciance. Et cela revient à dire que j’avais moi aussi perdu la sécurité de l’enclos. Comme Job, je ne pouvais plus compter sur ce Dieu gardien que j’avais désigné plus ou moins consciemment » (p. 53).
- une compréhension de la foi qui se manifeste comme une relation et non comme un système de croyances. Sa parole à Job est probablement le centre de sa thèse. Job s’écrie « Je sais bien, moi, que mon Défenseur ( goël ) est vivant, que le dernier, il surgira de la poussière (Jb 9,24) ». Et Marion Muller-Colard lui répond: « Voilà, mon ami Job. Tu tiens dans ta main la peau morte d’un Dieu que tu avais mandaté pour garder ton enclos. Mais tu sais, à présent, que ton Rédempteur est vivant. Ton goël , ton avocat, ton défenseur. Celui qui ne défend pas ton enclos mais ta quête d’un autre Dieu, celui qui mettra au monde avec toi une autre foi, qui t’accouchera d’une autre confiance. Tu passes d’une religiosité enfantine à une foi d’adulte, tu passes d’un système à une relation. Tu as perdu un Dieu fonctionnel qui s’est avéré, de surcroît, ne pas bien fonctionner. Tu as trouvé un Dieu vivant, qui t’échappe et que tu cherches » (p. 77).
- son émerveillement devant la vie. La prise de conscience de Marion Muller-Colard au chevet de son fils gravement malade est probablement le cœur de son expérience spirituelle : « La détresse m’avait dilatée et, en quelque sorte, elle avait élargi ma surface d’échange avec la vie. Et près de ce petit corps, se superposait à ma supplication muette pour qu’il vive, la conviction profonde que, quoi qu’il arrive , ce qui était incroyable et sublime, c’était qu’il fût né. Et que cela, jamais, ne pourrait être retiré à quiconque. Ni à lui, ni à moi, ni au monde, ni à l’histoire » (p. 82).
Pourquoi donc – devant tant de merveilles – risquer une critique ? Parce que nous avons l’impression désagréable que Marion Muller-Colard, dans sa quête d’une foi adulte, abandonne plusieurs points forts de la foi chrétienne.
Le Dieu berger
Certes, nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous protéger en échange de notre fidélité. Nous connaissons tous des exemples de croyants durement éprouvés, à commencer par Jésus !
Certes, il n’y a pas d’enclos – un terme central dans ce livre – qui nous garantirait contre les menaces de la maladie ou du malheur. Il n’y a pas d’enclos… mais il y a un Berger, qui nous accompagne jusque dans « un ravin d’ombre et de mort » (Ps 23,4). Même là, « je ne crains aucun mal car tu es avec moi » ( ibid. ).
Cette foi biblique contraste avec le constat désabusé de Marion Muller-Colard : « Rien de ce qui arrive à mon vieux frère Job, à mon fils, aux milliers d’humains sur qui s’abat un violent malheur, aucune maladie de ceux à qui j’ai rendu visite, aucun accident n’est injuste. Cela voudrait dire qu’il existe un enclos et un Gardien à cet enclos » (p. 74).
On rétorquera peut-être que l’image de Dieu comme Berger appartient à l’Ancien Testament. Notons pourtant qu’elle nourrit encore la foi de Jésus
, de Paul
ou de Pierre
. La Bible ne nous garantit pas une protection contre tous les dangers mais elle nous promet une Présence dans toutes les circonstances, même les plus douloureuses ou les plus décapantes. Le bon Berger n’abandonne pas ses brebis.
La résurrection
Marion Muller-Colard a trouvé « une foi sans filet dogmatique » (p. 107). Elle savoure la vie et ne s’intéresse pas à une quelconque « espérance eschatologique » (p. 93). « Quoiqu’il m’arrive, il est juste et bon que le monde soit, il est juste et bon que je participe, de façon tout à fait éphémère, à quelque chose de plus grand que moi. Et que ma marche fragile prenne appui sur la solidité des montagnes qui me survivront longtemps encore » (p. 107).
Dieu sait que j’apprécie énormément les montagnes ! J’organise depuis 1990 des semaines « Montagne et Foi » avec beaucoup de joie. Mais les montagnes ne me donnent aucun réconfort face à la vulnérabilité et à la mort… L’espérance chrétienne est ailleurs, dans le Christ ressuscité qui nous a ouvert le chemin de la résurrection. Notre vie n’est pas seulement éphémère ; elle est promise à la vie éternelle. Bien entendu, Marion Muller-Colard est libre de croire autrement mais cette foi ne ressemble alors plus vraiment à la foi chrétienne. L’apôtre Paul est formel : « S’il n’y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si Christ n’est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et vide aussi votre foi » (1 Co 15,13-14).
L’action de Dieu et l’espérance
Dans son cheminement spirituel, Marion Muller-Colard abandonne toute croyance en une protection de Dieu mais elle continue à croire en Dieu comme Créateur : « Pour le monde comme pour chacun, ce Dieu indifférent à mes comptabilités avait proclamé : ‘Que la lumière soit !’ Et la lumière s’était faite sur la terre. Elle s’était faite sur mon fils, sur chacun d’entre nous, petits êtres vulnérables…» (p. 89).
L’action de Dieu semble se borner pour Marion Muller-Colard à cette œuvre créatrice. Pour le reste, c’est à nous d’agir : « J’ai entrevu un Autre Dieu qui ne se porte pas garant de ma sécurité mais de la pugnacité du vivant à laquelle il m’invite à participer » (p. 93).
« Quoi qu’il arrive, réjouis-toi que le soleil, chaque matin se lève sur le monde et invite tous les désespérés à brandir avec lui une opposition inconditionnelle à la nuit. Respire, prends courage, ouvre tes volets. Tant qu’il fait jour, travaille aux œuvres de celui qui a créé la vie » (p. 101).
J’ai beau lire et relire le chapitre intitulé « La Grâce », Dieu semble se borner à donner la vie ; il semble s’être retiré de l’histoire du monde… et c’est à nous de prendre le relais. Aurions-nous affaire ici à une forme de déisme ?
Ou peut-être de stoïcisme ?
On est à mille lieues des évangiles, qui nous ouvrent à l’espérance en nous donnant à voir l’action de Dieu parmi les humains, dans la personne de Jésus. Les Actes des Apôtres montrent à leur tour que Jésus continue d’agir parmi nous. La foi chrétienne articule magnifiquement l’action de Dieu et l’action des humains : « Si nous peinons et si nous combattons, c’est que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, surtout des croyants » (1 ™ 4,10).
Nous ne sommes pas abandonnés à nos propres ressources ! Et nous pouvons prendre appui sur la fidélité de Dieu, la résurrection du Christ et le dynamisme de l’Esprit plutôt que sur le soleil et les montagnes.
Quand les montagnes s’en iraient,
quand les collines vacilleraient,
ma fidélité envers toi ne s’en ira pas,
et mon alliance de paix ne vacillera pas,
dit le SEIGNEUR, qui a compassion de toi
(Es 54,10).
* * *
Marion Muller-Colard nous offre une relecture très personnelle du livre de Job. Risquons-nous à en proposer une autre !
Une autre lecture de Job
J’entends plusieurs niveaux de réponse au problème du mal et de la souffrance dans le livre de Job :
– les « discours » des amis de Job sont enfermés dans une stricte logique de la rétribution : « si tu souffres, c’est que tu as péché ». Je rejoins Marion Muller-Colard pour remettre en cause cette logique. Un simple système rétributif, donnant-donnant, ne parvient pas à rendre compte de la complexité du réel
– les « discours » de Job protestent à la fois contre les accusations lancées par ses amis et contre les souffrances qui l’accablent. « C’est trop injuste !!! » Marion Muller-Colard abandonne toute idée de justice immanente (p. 71) mais Job continue à crier que ce n’est pas juste (voir par exemple sa « protestation d’innocence » au chap. 31).
Job n’a pas de réponse au problème du mal mais il continue à croire qu’il doit y avoir « quelque part » une justice et un « défenseur » (9,24). Et Job a raison de trouver que c’est injuste ! Cette protestation n’a rien d’une « religiosité enfantine ». Je note que le SEIGNEUR, à la fin du livre, lui donnera raison (42,7) : « Vous n’avez pas parlé de moi avec droiture comme l’a fait mon serviteur Job ».
– les « discours » de Dieu questionnent Job et l’amènent à reconnaître qu’il n’est pas en situation de se poser en juge : « Veux-tu vraiment casser mon jugement, me condamner pour te justifier ? » (40,7).
Marion Muller-Colard interprète les nombreuses allusions à la nature comme une invitation à y puiser le courage de vivre : « Mais je réappris ce jour-là avec lui la réponse de Dieu à Job : s’il n’existe aucun système explicatif du mal, aucun dogme ni grigri qui fassent l’économie de notre vulnérabilité, il existe la solidité des montagnes, la fidélité des paysages, le foisonnement végétal qui redonne fidèlement ses fruits chaque saison. Et nous pouvons appuyer les petits pas de notre marche précaire sur la stabilité du minéral et le renouvellement du vivant » (p. 95). On comprend qu’une amie lui adresse cette remarque pertinente: « Tu crois en la Nature comme en un Dieu » (p. 99).
J’entends plutôt les chapitres 38 à 41 comme des défis que le SEIGNEUR lance à Job pour lui montrer qu’il n’est pas en position de saisir toute la complexité du monde :
« Où est-ce que tu étais quand je fondais la terre ? » (38,4)
« Es-tu parvenu jusqu’aux sources de la mer ? (38,16)
« Est-ce toi qui donnes au cheval la bravoure ? » (39,19)
Et Job comprend le message : « Je ne fais pas le poids, que te répliquerai-je ? » (40,4).
Pourquoi Marion Muller-Colard interprète-t-elle ces chapitres dans le sens d’une célébration de la nature – sur laquelle je peux prendre appui – plutôt que du respect du mystère ? Là encore, Job a compris le message :
« Qui est celui qui dénigre la providence sans y rien connaître ? Eh oui ! J’ai abordé, sans le savoir, des mystères qui me confondent » (42,3).
La présence de Dieu dans la souffrance est effectivement de l’ordre du mystère. Nous y reviendrons.
– le prologue (en prose) nous permet d’entrevoir que la souffrance de Job n’est ni injuste ni absurde. On y découvre une toute autre logique que celle de la rétribution. Dans ce mystérieux dialogue entre le SEIGNEUR et l’Adversaire, Job n’apparaît pas comme un coupable qui mériterait de souffrir mais comme un juste qui reçoit – sans le savoir – la mission de répondre au défi de l’Adversaire : « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l’as-tu pas protégé d’un enclos, lui, sa maison, et tout ce qu’il possède ? » (1,9).
L’action de l’Adversaire n’est pas une explication globale du problème du mal mais c’est un des éléments de réponse à ne pas négliger. Jésus y fait allusion dans la parabole de l’ivraie et du bon grain. Aux serviteurs qui l’interrogent : « Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D’où vient donc qu’il s’y trouve de l’ivraie ? », le maître répond : « C’est un ennemi qui a fait cela » (Mt 13,27-28).
Notons cependant que Job ignore tout de ce dialogue céleste. Rester fidèle à Dieu même quand je ne comprends plus ce qui m’arrive – même quand l’enclos est renversé – est le défi que rencontrent tous les persécutés, voire tous les souffrants. La présence de la souffrance n’indique pas l’absence de tout enclos et de toute justice. Même si je ne parviens pas à comprendre, je peux continuer à croire que le SEIGNEUR veille sur nous
.
Gérard Pella, pasteur réformé, Attalens.
Le vrai visage de Dieu
Je tiens tout d’abord à souligner que j’adhère en tout point à la critique « positive » de Gérard Pella. Mais si je suis plein d’admiration devant les aspects positifs du livre de Marion Muller-Colard, je constate moi aussi que cette théologienne protestante a bel et bien jeté le bébé avec l’eau du bain. A la critique « négative » de Gérard Pella, à laquelle je souscris entièrement, et toujours dans un esprit de « dialogue », je me permets d’ajouter les considérations suivantes.
Quand elle parle de l’Autre Dieu, Marion Muller-Colard nous donne à penser que nous allons découvrir, au-delà des fausses images de Dieu, le vrai visage de Dieu. Mais quel théologien pourrait prétendre parler du Vrai Visage de Dieu à partir du seul livre de Job – ou même à partir de l’Ancien Testament seulement ?
L’Autre Dieu, le vrai Dieu, le « seul vrai Dieu » (Jn 17,3), c’est celui qui s’est révélé en son Verbe fait chair. On ne peut parler de cet Autre Dieu – le Vrai – qu’à partir de celui qui est « resplendissement de sa gloire et expression de son être » (He 1,3 ; cf. Jn 1,18 ; 14,9). Or tout ceci est totalement absent de la pensée théologique de Marion Muller-Colard. Si cette pensée théologique semble « originale », elle n’est pas authentiquement chrétienne puisqu’à aucun moment on ne voit cette pensée fondée sur la révélation du Vrai Dieu en son Verbe incarné. Cette lacune rejaillit sur la manière d’aborder le mystère du mal. Il est absolument impossible de parler du Vrai Dieu dans sa relation au mystère du mal en dehors du mystère de la passion et de la croix du Christ :
- la passion et la croix nous révèlent que Dieu n’est pas l’auteur du mal mais qu’il en est la première victime !
- la passion « visible » du Fils révèle la compassion « invisible » du Père.
- de plus, dans son agonie à Gethsémani et dans sa mort sur la croix, Jésus révèle qu’en lui Dieu « épouse » notre condition humaine déchue avec toutes ses conséquences. Dieu nous a créés pour nous « épouser ». Quand sa fiancée s’est retrouvée « défigurée », vouée à la déréliction et à la mort, Dieu n’a pas abandonné son projet. En son Fils, il est venu nous rejoindre en « enfer » et il est venu nous « épouser » sur la croix dans notre condition de damnés. « Celui qui n’avait pas connu le péché, il l’a, pour nous, identifié au péché, afin que, par lui, nous devenions justice de Dieu » (2 Co 5,21).
La véritable profondeur du mal, telle qu’elle apparaît dans la passion et dans la mort de Jésus-Christ, est totalement absente du livre de Marion Muller-Colard, qui semble bien ignorer la nature même du péché. Et par conséquent la véritable profondeur de l’amour de Dieu, qui vient nous rejoindre en « enfer », est totalement absente de son livre elle aussi. Il est impossible de parler du Vrai Dieu en relation avec le mystère du mal en se contentant du livre de Job.
L’Autre Dieu de Marion Muller-Colard ne ressemble pas vraiment au Dieu de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Voilà ce qu’un chrétien doit avoir le courage d’affirmer. Comprenez-moi bien : je ne veux forcer personne à partager ma foi chrétienne… mais je trouverais malhonnête que quelqu’un mette du Goron dans une bouteille étiquetée « Cornalin » !
Yvon Kull, Martigny, chanoine de la congrégation religieuse du Grand-Saint-Bernard, auteur du livre
Revisiter l’enfer ou comment devenir immortel, Editions Parole et Silence, 2017.

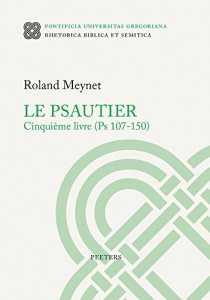 , Le psautier , Cinquième livre (Ps 107-150), Louvain, Éditions Peeters 2017 – ISBN: 978-90-429-3510-5 – 747 p. – € 72,–.
, Le psautier , Cinquième livre (Ps 107-150), Louvain, Éditions Peeters 2017 – ISBN: 978-90-429-3510-5 – 747 p. – € 72,–.