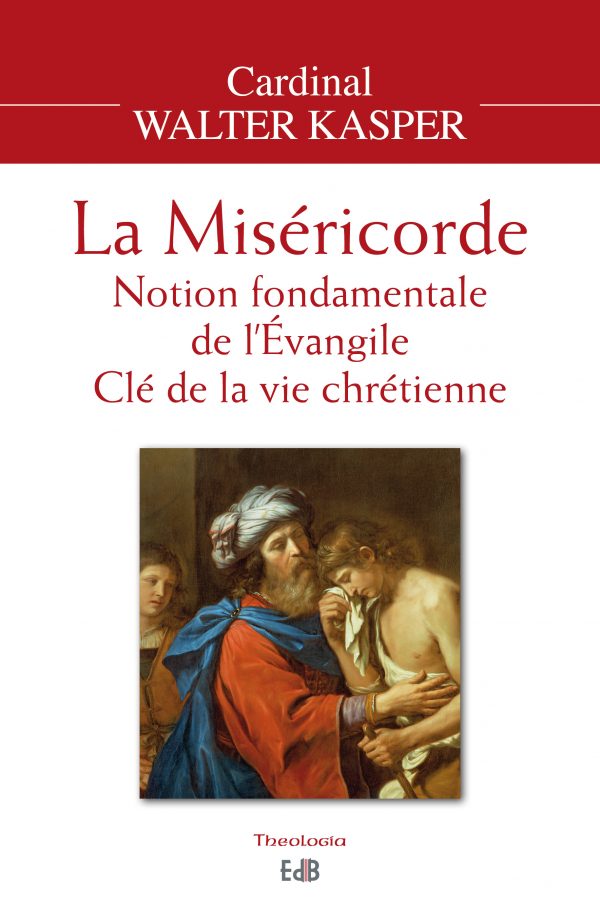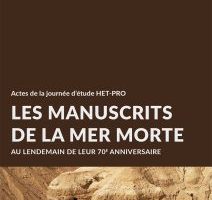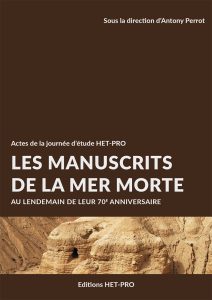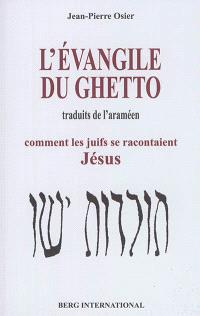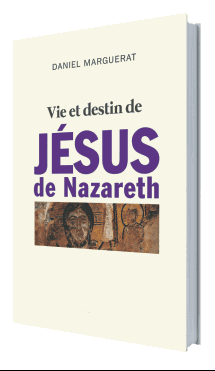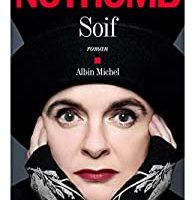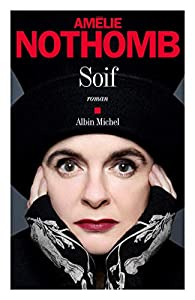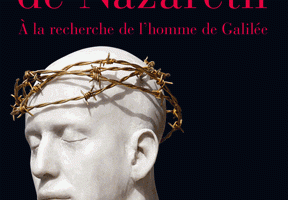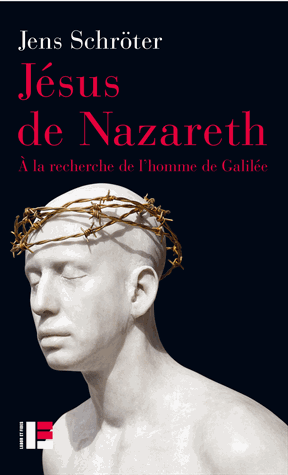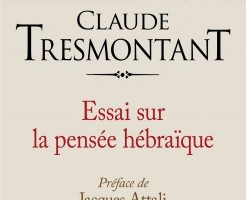Claude Tresmontant, Essai sur la pensée hébraïque , Paris, Éditions du Cerf, 2017 – ISBN 978-2-204-12238-2 – 174 pages – € 14,– ou CHF 21,–.
Claude Tresmontant, Essai sur la pensée hébraïque , Paris, Éditions du Cerf, 2017 – ISBN 978-2-204-12238-2 – 174 pages – € 14,– ou CHF 21,–.
Philosophe, exégète et métaphysicien, spécialiste de l’hébreu et traducteur des quatre Évangiles et de l’Apocalypse, Claude Tresmontant (1925-1997) a été professeur de philosophie médiévale, puis de philosophie des sciences à la Sorbonne. Il fut également correspondant de l’Académie des sciences morales et politiques. Il obtint le grand prix de l’Académie des sciences morales et politiques pour l’ensemble de son œuvre en 1987. Pour notre propos, il est intéressant de savoir que, né dans une famille athée, il se convertit d’abord au protestantisme, puis adhéra au catholicisme. Parlant de Tresmontant, le Grand Rabbin Kaplan écrivait : « Nous, nous savons de l’hébreu, lui il sait l’hébreu » (p. I).
Le livre que nous présentons ici est déjà paru en 1953. Il s’agit donc d’une réédition, avec une préface de Jacques Attali. Il faut être reconnaissant aux Éditions du Cerf de republier cet ouvrage important, devenu un classique, mais auquel je n’avais jamais pu accéder jusque-là. Vu son importance, j’en donnerai une analyse plus détaillée que d’habitude. Il m’a été très précieux pour synthétiser et nouer la gerbe d’un grand nombre d’épis glanés ici et là sur la pensée hébraïque et surtout pour mettre en perspective la pensée biblique par rapport à la pensée indo-européenne, avec son dualisme, qui nous est essentiellement parvenue à travers la Grèce et Rome.
Dans son introduction, l’auteur nous avertit que ce « n’est qu’une esquisse, ou si l’on veut, une épure » (p. 11). De leur côté, les éditeurs nous rappellent que c’est l’œuvre d’un philosophe, non d’un théologien (p. 9). Et effectivement, Tresmontant ne semble pas connaître (en tout cas il ne les cite quasiment pas, à part Dhorme) les auteurs qui, à son époque déjà, avaient mis en lumière les conceptions sémitiques du monde et de l’homme, si différentes des conceptions gréco-romaines ; citons en particulier J. Pedersen dont les études sur Israël (1926) ont constitué, d’après Georges Pidoux en 1953, un tournant dans l’étude de l’AT. Ce fait rend l’essai de Tresmontant d’autant plus remarquable ; car, si on pourrait préciser ou nuancer ici et là certaines de ses affirmations, sur des questions de détail, on ne peut qu’être ébloui de la pénétration avec laquelle il nous fait entrer dans la pensée biblique tout en la mettant en regard (et c’est l’un de ses points forts) avec la pensée grecque et moderne. Pour cela il empruntera plusieurs de ses analyses à Bergson dont il sait se distancer à l’occasion (cf. son excursus, pp 155-162).
I. La création et le créé (pp 13ss)
Il commence par traiter de la notion de création. Pour les Grecs, la création est comprise comme une dégradation, une chute qui part de l’Un pour aller au multiple et à la matière, perçue comme mauvaise. La pensée hébraïque, avec sa notion
de Un (
’eCHaD appliqué à Dieu – Dt 6,4)
pourrait paraître similaire, mais il y a une différence essentielle : pour les hébreux, l’Un est le vivant qui donne la vie et crée (idée de création). Il n’y a pas deux principes (dualisme) éternels comme chez les Grecs. Le mal n’est pas perçu comme
l’
opposé dialectique et permanent du bien comme chez Platon (Théétète 176a), mais comme une réalité due au mensonge. L’idée de création implique la distinction radicale entre créateur et créé (p. 20), ce qui n’empêche pas le créé d’être considéré comme « très bon » (Gn 1,31). Le problème du mal s’en trouve changé : le péché en particulier, n’est pas lié spécifiquement au matériel, il est spirituel : c’est le mensonge (p. 22). Refuser la notion biblique de création, c’est refuser les notions de temps, d’amour, de personne : ce sont des apports spécifiques de la Bible (p. 25).
Le Temps : La notion de temps est connotée à celle de création (p. 26) : sans temps, la création serait un processus achevé. La création est dynamique ; elle implique une idée de vie, de développement et d’évolution, de nouveauté » hodesh » (Jr 31,22 et diverses références à la p. 26). La philosophie, avec son idée d’Être une fois pour toutes, n’a jamais admis cette possibilité d’imprévisibilité (p. 27). Pour Platon, le temps n’est qu’une imitation mobile de l’éternité (Timée 37b). Les philosophes voient le temps négativement, comme « l’ensemble des obstacles que rencontre l’éternité », selon la formule de Bergson citée à la p. 31. Dans la perspective de la création, le temps est positif : il est le lieu des mouvements de la vie (pp 31-32), dont l’évolution fait partie. Le « panta rei » (« tout s’écoule ») d’Héraclite est pessimiste, tout vieillit, va vers la mort, alors que dans la Bible, il est un temps d’espérance et de vie ; pour les Grecs, c’est la lumière qui disparaît dans la nuit, pour la Bible, la graine qui devient un arbre (pp 34-35).
Être prophète c’est avoir l’intelligence des temps et de leur maturation (1Ch 12,33, Mc 1,15 (pp 35-38). À la p. 38, Tresmontant pose la question, avec Bergson dont l’analyse lui a été utile : Si l’on n’est pas capable d’assumer la notion de temps, comment celle d’éternité le sera-t-elle ? Pour Tresmontant, il faut assumer le temps pour assumer l’éternité. Le prophète n’a pas accès à l’avenir, à la façon d’un astrologue, comme si tout était déjà fait ou écrit ; il a un certain accès à l’avenir, parce qu’il connaît le créateur, à la manière du paysan qui peut « prédire » le moment de la récolte. Pas de fatalisme dans la Bible. Le temps n’est pas l’image de l’éternité de Platon ; il permet la liberté et donc l’amour ! L’homme, comme « collaborateur de Dieu » (1 Co 3,10), est libre (pp 43-45).
Ensuite Tresmontant fait la différence entre la création qui est le fait de Dieu et la fabrication qui est celui de l’homme. Une chaise en bois est un arbre modifié : le bois est création de Dieu, la chaise fabrication de l’homme (45-47).
L’idole est un objet fait de main d’homme, donc fabriqué ; elle est un rien que l’on prend pour un dieu ; il y a confusion entre être et néant, créé et créature. L’objet fabriqué (par exemple une chaise) n’a pas de vie, il n’y a pas d’« information » transmise pour qu’il se reproduise lui-même, comme un arbre ; il n’est qu’une chaise. C’est l’homme qui lui donne sa forme (pp 47-51).
Dans la pensée hébraïque, on ne trouve pas la distinction entre forme et matière comme dans Aristote (Physique Il 191a). La matière n’existe pas, c’est un thème abstrait, de même que le chaos opposé à la création n’existe pas. Le « tohou wabohou » de Genèse 1,2 désigne le désordre que Dieu a dominé pour que la terre soit habitable par l’homme, mais ce n’est pas une sorte de Tiamat que Dieu aurait dû vaincre préalablement à la création (pas de vision dualiste). Pour Hésiode, par contre, Chaos est antérieur à Gaia (la Terre – Théogonie 116). Dans la Bible, Dieu seul est antérieur à la création : donc pas de théogonie encore moins de théomachie ! (pp 52-56).
Si l’hébreu n’a pas de mot général pour matière , chaque élément créé a un sens. « La signification du sensible s’explique par le fait qu’il a été créé par une parole ; il est lui-même un langage, la manifestation d’une parole créatrice » (p. 58). Tout vient de la parole créatrice : Adam, en nommant les animaux, fait de chacun d’eux une âme vivante, le peuple d’Israël dépend de Dieu qui par sa parole, par exemple, envoie la pluie. L’huile signifie l’Esprit, le feu, l’amour, mais aussi l’Esprit avec son côté ambigu qui purifie ou détruit. Le sensible est réalité et signe. (56-64).
À la p. 64, Tresmontant fait une distinction importante entre le mashal (= comparaison, parabole) et l’allégorie platonicienne : partant de ce qui vient d’être dit, le mashal est une réalité sensible bien concrète, une histoire, qui « signifie » une réalité non-sensible. Au contraire, Platon nous fait sortir du sensible pour connaître le monde des idées – dans le mythe de la caverne, les hommes sont enchaînés et n’accèdent que par des ombres à la réalité du monde idées (Platon, Rép. VII,514a ss). Dans cette logique, la contemplation biblique passe par le concret du sensible, alors que la contemplation platonicienne la « fuit » (p. 66) – cela ouvre une perspective intéressante pour l’interprétation de l’évangile de Jean : l’utilisation du symbole ne signifie pas forcément non-historicité (p. 65, note 1). Cette conception de la réalité comme signe explique le rôle du mariage comme signe de l’amour de Dieu pour l’Église (Éph 5,22ss). Il me semble intéressant de mettre en regard Tresmontant avec « L’amour et l’occident » de Denis de Rougemont : les occidentaux, à l’instar de Platon, recherchent et aiment la beauté, l’amour, alors que l’homme de la Bible aime une personne (pp 66-67).
Dès le bas de la p. 67, il fait un développement sur la mission d’Israël de libérer les nations de l’idolâtrie. Ce peuple n’a pas fait de monument à la beauté, car la beauté, c’est quelqu’un. « L’incarnation, c’est le choix du particulier, du réel avec toutes ses contingences historiques, géographiques… » (p. 69). Cette méthode de l’incarnation est contraire au dualisme ; « L’Écriture est une métaphysique et une théologie sous les espèces du récit historique ». Dieu, dans cette logique, a choisi un peuple particulier pour se révéler au monde (p. 70).
Pour être d’Israël, il faut être circoncis ; cela représente une volonté, une fidélité, mais le vrai Israël est défini par l’Esprit, non par l’hérédité (Rm 2,26). Remarquons que la particularité du signe est de permettre le mensonge. Un arbre qui n’a plus de sève peut paraître vivant, mais il est mort (p. 71). Le NT fait tomber l’« écorce du signe », il procède à une extension ou à une généralisation de la Torah (Sermon sur la montagne par rapport à la Torah – pp 72-74).
Israël est le mutant d’une espèce nouvelle : il est saint, consacré à Dieu et de ce fait différent des autres nations. Pas de magie en Israël (Nb 23,23), mais Israël a la tentation de fuir cette vocation. Le désert est là pour le purifier des habitudes des nations, les fêtes des pèlerinages la lui rappellent
;
le NT est dans la même ligne : nous sommes aussi pèlerins sur cette terre (1 Pi 2,11). Ce sont des « tupoi » (types) que le NT peut discerner dans l’AT, parce qu’il y a continuité dans le plan de Dieu entre Israël et l’Église, comme il y a continuité entre une graine et un arbre. Ainsi, « la guerre pour Israël est le résultat d’une infidélité » ; c’est un type signifiant que
« la vérité ne tolère pas que quelque chose d’elle soit perdu. » Quand l’Église oublie une part de la vérité, des hérésies la lui rappellent (Marx et le communisme, quand elle a oublié les pauvres – Freud, quand sa spiritualité a été maladive – Nietzsche, pour remédier à une perversion de l’éthique évangélique, etc. – p. 81). Tresmontant voit l’histoire de l’humanité avec une image botanique : une graine toute petite, au départ, comme Israël, et qui grandit. Elle est vie, c’est un processus, mais cette croissance permet de garder des analogies entre hier et aujourd’hui. Les problèmes rencontrés sont analogues (pages 74-83).
L’incarnation : Israël était incarné, cette incarnation se manifeste pleinement ou culmine en Jésus, en qui est présente toute la plénitude de la divinité (Col 2,9). Cette idée le l’incarnation est un scandale pour la pensée grecque, elle a été combattue par les philosophes, la cabale et la gnose (pp 83-86).
II. Schéma de l’anthropologie biblique (pp 87ss)
Elle se caractérise par :
A) le non-dualisme grec. Dans la dialectique biblique, l’opposition n’est pas entre corps et âme comme dans la Grèce, mais entre bassar , (traduit traditionnellement par « chair », mais qui désigne l’humain dans sa globalité corporelle et psychique) et Rouach , l’Esprit, qui représente l’élément divin permettant à l’homme de participer à la vie de Dieu.
Ensuite Tresmontant présente l’anthropologie grecque : il y a certes des différences selon qu’on lit Platon, Aristote ou Plotin, mais, fondamentalement, elle voit le corps comme la prison de l’âme, qui devient cadavre quand elle est séparée de lui (pp 90-91). À la p. 92, il dit qu’en hébreu le mot « corps » n’existe pas ; il y a des mots pour cadavre, le mot « bassar » désigne un être vivant fragile, mais rien de mauvais en soi. Le mal n’est pas lié spécifiquement à la chair, mais la chair est faible, contrairement à l’Esprit. À la p. 95 on trouve que l’homme n’a pas une âme, mais qu’il « est » une âme (nefesh). « Bassar » et « nefesh » sont utilisés indifféremment l’un pour l’autre. « Bassar »= l’homme dans sa fragilité par opposition à l’Esprit. Mais pas de dualisme corps-âme. Chaque être humain est une création particulière, appelée à être aimée. À la p. 100, il dit que la personne est marquée par le nom ; ce nom est son essence propre. Cette conception biblique change la conception du mal qui n’est pas vu comme corporel (cf. Platon, où le corps est une prison – Phédon 83d-84d), mais comme spirituel. Le mal, c’est le péché, même s’il n’a rien à faire avec le corps. La manière dont on conçoit le sensible et le corporel est une pierre de touche pour savoir si une sagesse est biblique ou pas (p. 101).
L’âme (nefesh) peut vivre ou mourir, par contre l’Esprit ne meurt pas. L’âme a faim, elle a des émotions corporelles (exemples d’anthropologie biblique avec reins, entrailles, etc. – pp 102-104). En conclusion, il établit la différence entre sémites et aryens : les premiers ont gardé l’union entre la sensation et l’idée, pas les seconds. Ce goût et cette intelligence du charnel n’est possible que s’il n’y a pas de séparation dualiste entre charnel et spirituel. « L’hébreu a le sens et l’amour du charnel, parce qu’il a le sens du spirituel, le sens de la présence du spirituel dans le charnel ». Dans l’amour, si l’homme est une âme vivante, il connaît l’autre par son corps (p. 105). Dans cette optique, il fait une remarque intéressante, inspirée de Jousse, sur l’importance de l’unité corps-âme, dans la transmission rabbinique : la Parole y est liée à des gestes qui en facilitent la mémorisation et par là l’intériorisation (p. 106). La résurrection ne peut être que corporelle, puisque sans corps l’âme ne peut être présente (p. 107).
B) la présence de l’Esprit qui est la part surnaturelle venant de Dieu. Dès le bas de la p. 107, il parle de la dimension capitale de la « Rouach », l’Esprit, qui permet à l’homme d’être en contact avec Dieu. L’homme est un être faisant le passage (« pessach ») entre le créé et le créateur. Le dualisme biblique esprit-corps est la différence entre divin et créé, alors que dans la conception grecque, c’est la différence entre bien et mal. Parfois, il est difficile de discerner chez Paul si l’ »esprit » est celui de l’homme ou de Dieu. Mais Jean 1,12-13 montre bien la différente entre ce qui est né de la chair et ce qui est né de l’Esprit (pp 109-112). Dans la Bible, la division entre spirituel et psychique est identique à l’opposition spirituel-charnel. L’irruption de l’Esprit dans l’homme est la clé de la théologie chrétienne : sans l’Esprit, 1, le christianisme n’est plus qu’une morale et une ascèse ; et 2, la révélation chrétienne perd son aspect surnaturel et donc perd son sens. Les trois vertus théologales, la foi, l’amour et l’espérance sont éminemment pneumatiques (pp 112-115).
III. L’intelligence (p. 117ss)
La particularité de la Bible est de considérer la réalité comme créée. L’homme est responsable de ses pensées, c’est lui qui les crée. En lui Dieu a déposé la vérité dans son cœur, sa conscience ( suneidésis ) le lui confirme ; mais cette vérité, il peut la refouler, et écouter le mensonge (le contraire de la vérité, c’est le mensonge, pas l’erreur). Quand il écoute le mensonge, l’homme a un « cœur double » – litt. « un cœur et un cœur » (Ps 12,3) : c’est un hypocrite . D’où la prière d’unifier son cœur (Ps 86.11). On est dans la même ligne que « sincérité du cœur
» (litt. La « non-double-face du cœur », de Col 3,22). C’est donc le péché qui se porte vers l’homme (Gn 4,6) qui crée une dualité en lui. Quand le mal est entré, il se forme en l’homme un calus, qui endurcit et obscurcit l’intelligence (Éph 4,18) que Dieu doit briser (idée de brisement, p. 122). La stupidité est un acte d’endurcissement (Job 17,4, voir Rm 1,21). L’intelligence, c’est écouter Dieu (Dt. 6,4, etc.) – p. 123. Le mot grec » nous » (raison, intelligence), n’a pas d’équivalent hébreu. L’idée d’intelligence est rendue par cœur , ( lev en hébreu ou kardia en grec) . L’intelligence est une action ; on la demande à Dieu, qui la donne. L’intelligence est une action établie quand la Rouach habite en l’homme. Elle est donc spirituelle (Col 1,9). Elle est liée à la vie, son absence signifie la mort ; l’intelligence est donc liée à la sainteté (Pr ,10) et elle caractérise l’ère messianique (És 11,9). L’intelligence débouche sur la » tsedaka « , la justesse de la relation avec Dieu et avec le prochain (124-129).
La Torah est une pédagogie de l’intelligence et de la liberté ; le précepte qui oblige à l’action suscite en même temps l’Esprit qui est ainsi don de Dieu (voir les versets des Ps 19 et 119 où il est dit que la Torah éclaire ou illumine – pp 129-130).
« L’intelligence consiste à discerner ce qui, au cœur de la création en genèse, au cœur de l’histoire, en est le principe, le germe ». La création est comme un germe qui a tout son potentiel : celui qui a l’intelligence croit et espère le fruit alors qu’il n’y a qu’un petit germe : le temps est donc inhérent à l’intelligence qui espère. L’échec fait partie de ce processus (pp 130-131). « L’intelligence spirituelle – surnaturelle – qu’est la foi, consiste à discerner le Germe qui travaille au cœur de la création et qui en est le principe et la raison » (p. 132). Le Messie est le Germe, il est la Parole. La foi c’est discerner les signes du messie, sans s’arrêter à ces signes extérieurs, mais en allant à la connaissance à laquelle ils conduisent ; la foi est connaissance : « Nous avons cru, et nous avons connu… » (Jn 6,69). « La pistis (foi, confiance) est l’acte essentiel de l’homme, celui qui le définit » (p. 136). C’est pourquoi elle est justice.
La foi n’est pas opposée à la raison, mais elle est opposée à la raison formatée par la pensée grecque. Le gnosticisme nie le fait de l’incarnation, il est docète et pense que l’allégorie est meilleure que l’interprétation littérale ; d’où la nécessité du « renouvellement de l’esprit ».
La métaphysique biblique est du côté du vivant, elle est plus adéquate pour la science que la métaphysique grecque, car, pour le dire avec les mots de Jacques Attali (p. II) : elle fait de la place pour « un donné capital (qu’ignorait Kant) : le fait que toute apparition de nouveauté dans l’Univers s’effectue ou se réalise par communication d’informations » – la vie se transmet par la communication d’informations. La logique grecque est-elle « capable de comprendre la croissance d’un arbre à partir d’une graine ? » (p. 140). L’opposition foi-raison vient des Grecs qui n’avaient pas compris ce qu’est le renouvellement de l’intelligence ; d’un point de vue grec, la foi est une hubris , car le chrétien ne désire rien de moins que de participer à la vie de Dieu. Israël est le lieu où s’est préparé cette révélation.
Conclusion
Dieu a voulu des êtres humains qui participent à sa vie divine, mais l’amour implique la liberté. Tresmontant (qui n’a pas vu le mérisme dans l’expression « connaître le bien et le mal » de Gn. 3), voit le péché de l’Adam comme collectif (p. 148). L’homme a perdu la connaissance de Dieu et par là, son assurance devant Dieu ; il est toujours en-deçà de ce que Dieu voudrait pour lui. « La souffrance et l’échec sont l’intervention de Dieu pour que l’homme ne s’installe pas dans une condition qui n’est pas la béatitude, sa vocation » (p. 150). Toutes les hérésies ou erreurs philosophiques ont été rendues indispensables par une défaillance de la chrétienté. À la p. 151, il parle de la guerre dans cette optique (note 1). Nous sommes appelés à la sainteté, c’est-à-dire à porter du fruit, à être créatifs. « Les grands saints sont de grands créateurs » (p. 152).
Trois excursus terminent l’ouvrage :
1 : sur Bergson dont il a repris certaines analyses, mais dont il voit aussi les faiblesses.
2 : le souci : c’est ce qui, dans la vie, nous accapare tellement que l’on est empêché de nous occuper de ce pour quoi on vit.
3 : la pensée hébraïque et l’Église catholique. Il voit l’Église comme un corps vivant capable de s’auto-défendre contre les agressions externes ou internes (dans la ligne de ce qu’il a écrit aux pp 81 et 152). Parfois des hérésies arrivent, mais sont corrigées lentement. Il a une pique contre les Églises réformées, qui pourtant voulaient évacuer toute pensée païenne au profit de la Bible, mais dans les faits, elles ont aujourd’hui évacué ce qui fait l’originalité et la force du message biblique (il vise, sans la nommer directement ici, la critique biblique allemande – Cf. Tresmontant, Le Christ hébreu, OEIL 1983, p. 203ss).
L’Essai de Tresmontant sur la pensée hébraïque serait certes à reprendre aujourd’hui à nouveaux frais : les recherches sur la pensée sémitique se sont beaucoup enrichies au cours de ces dernières décennies. Il n’en demeure pas moins que ses bases sont solides. L’étude et l’assimilation de ce livre devrait faire partie du bagage des biblistes et être inscrit au programme de tout Bachelor en théologie.
Alain Décoppet